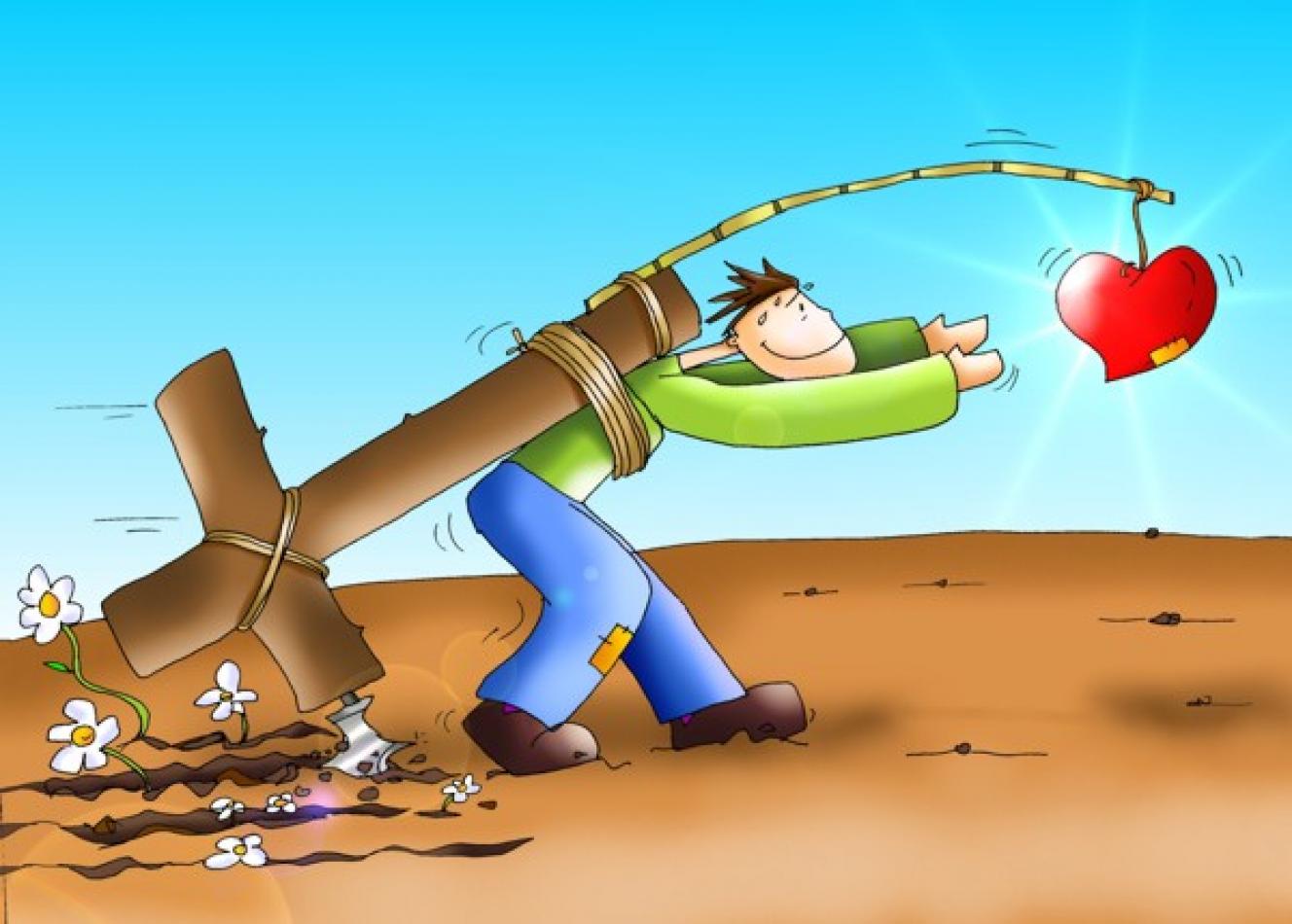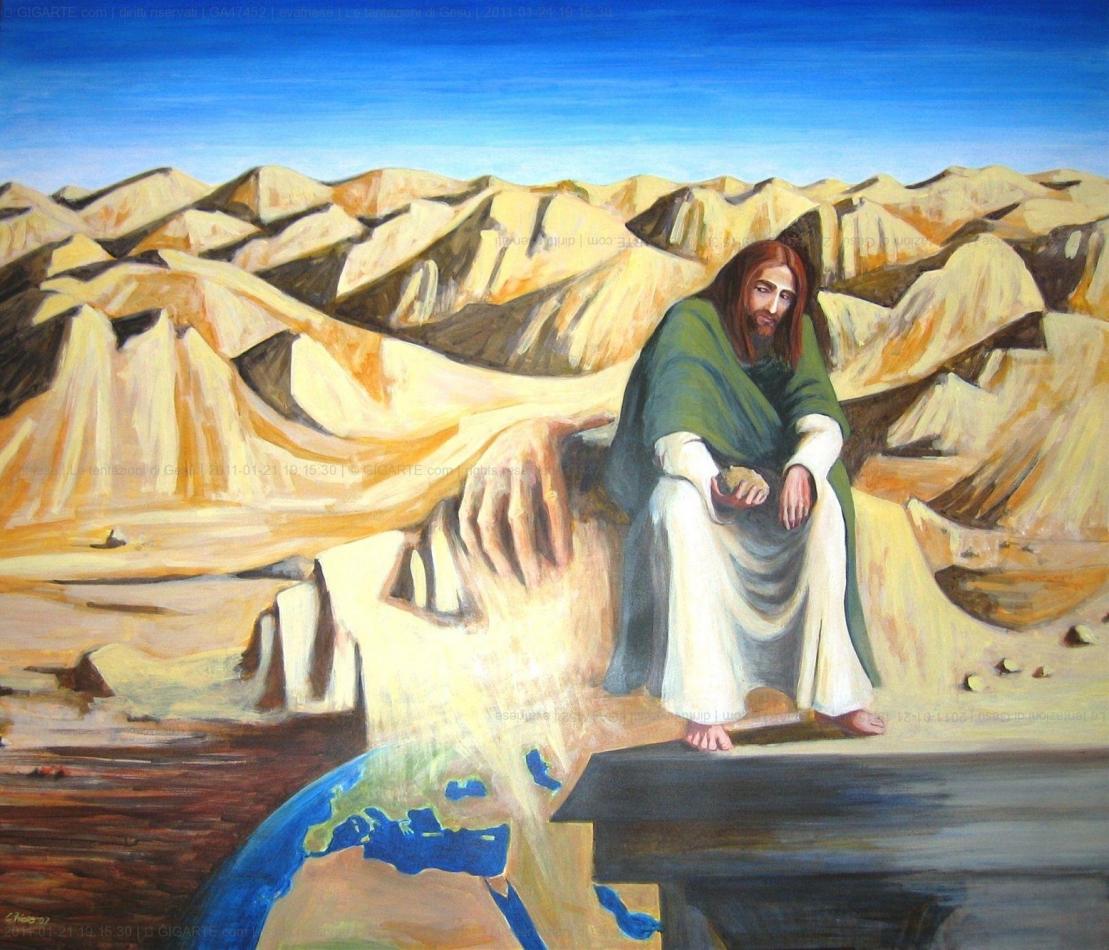Daniel Comboni
Missionnaires Comboniens
Zone institutionnelle
D’autres liens
Newsletter
Aujourd'hui, Jésus propose des exigences paradoxales. À celui qui veut le suivre, il présente trois conditions non négociables : 1) le préférer à sa famille et à soi-même ; 2) porter sa croix ; 3) renoncer à ses biens. Ce sont trois conditions qui touchent toutes les dimensions de la personne : la relation aux autres, à soi-même et au monde. Il s’agit d’un triple renoncement : des affections, de la vie et des biens.
« … Il ne peut pas être mon disciple ! »
Luc 14,25-33
Nous sommes en chemin avec Jésus vers Jérusalem. Un voyage long, non pas tant à cause de la distance, mais de sa durée. Dans cet itinéraire, saint Luc insère de nombreux épisodes, rencontres et enseignements de Jésus. Il s’agit d’un procédé littéraire de l’évangéliste pour nous introduire au mystère du suivi du Seigneur.
Luc ouvre le récit en disant : « Comme le temps approchait où il allait être enlevé au ciel, Jésus prit résolument la route de Jérusalem » (Lc 9,51). Le voyage se terminera aux portes de la ville sainte, avec les larmes de Jésus : « Quand il fut proche, à la vue de la ville, il pleura sur elle, en disant : Si toi aussi, tu avais su en ce jour ce qui te donne la paix ! » (Lc 19,41). Et le Seigneur continue aujourd’hui encore de pleurer sur sa ville. Et peut-être aussi sur nous, qui avons ignoré tant de ses visites !
Jésus, un prophète irritable ?
Après le déjeuner chez l’un des chefs des pharisiens (évangile de dimanche dernier), nous retrouvons aujourd’hui Jésus de nouveau en chemin. Nous sommes au cœur de son voyage (Lc 9,51–19,44). L’Évangile du jour commence en disant qu’« une grande foule faisait route avec lui » : une foule enthousiaste, peut-être exaltée. Pourtant, Jésus semble presque agacé par toute cette foule. Il ne cherche pas des “followers”, mais des disciples. Il a peut-être pensé : « Ces gens-là n’ont rien compris ! » Jésus se sent incompris. Combien de fois a-t-il vécu des moments de déception, goûtant l’amertume de l’échec ?
Jésus avait déjà annoncé aux apôtres, à deux reprises (cf. Lc 9,22 et 9,43-45), que les choses ne se termineraient pas bien à Jérusalem. Son voyage n’était en rien une marche triomphale. Après le second annonce de la Passion, l’évangéliste commente : « Mais eux ne comprenaient pas cette parole ; elle leur restait voilée, si bien qu’ils n’en saisissaient pas le sens, et ils avaient peur de l’interroger à ce sujet » (Lc 9,45). Les apôtres ne comprenaient pas. Mais on devine que, peut-être, ils ne voulaient même pas comprendre. Tout comme nous, qui faisons souvent la sourde oreille face à la Parole !
En réalité, Jésus n’a pas été tendre, même avec les foules, depuis qu’il s’est mis en route vers Jérusalem. Si nous parcourons les chapitres précédents, nous trouvons des paroles très dures adressées aux gens : « Cette génération est une génération mauvaise » (Lc 11,29) ; « Hypocrites ! Vous savez interpréter l’aspect de la terre et du ciel ; comment se fait-il que vous ne sachiez pas interpréter le temps présent ? » (Lc 12,56). Jésus entre en conflit avec tout le monde. Il n’est tendre qu’avec les apôtres, malgré tout (cf. Lc 10,21-24 ; 12,4-7 ; 12,32).
Et pourtant, les foules étaient attirées par ce rabbi si singulier, et elles continuaient d’espérer qu’il soit le Messie attendu. Peut-être étaient-ce les mêmes foules qui, jusqu’à il y a quelques décennies, remplissaient aussi nos églises !…
Jésus n’a pas peur de défier cette foule de sympathisants, comme il l’avait déjà fait un jour dans la synagogue de Capharnaüm. Alors, « beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui », en murmurant : « Cette parole est dure ! Qui peut l’écouter ? » (Jn 6,60-66).
Jésus, un maladroit recruteur vocationnel ?
« Il se retourna et leur dit :
- ‘Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple’ » (v. 26) ;
- « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple » (v. 27) ;
- « Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut pas être mon disciple » (v. 33).
Jésus avait toujours été franc et clair sur les exigences du suivi, tant avec ceux qui se proposaient de le suivre qu’avec ceux qu’il appelait lui-même (cf. Lc 9,57-62), mais jamais autant qu’ici. Ce sont des paroles dures, choquantes, provocantes, destinées à secouer la conscience des foules d’hier comme la nôtre aujourd’hui.
Jésus propose des exigences paradoxales. À celui qui veut le suivre, il présente trois conditions non négociables : 1) le préférer à sa famille et à soi-même ; 2) porter sa croix ; 3) renoncer à ses biens. Ce sont trois conditions qui touchent toutes les dimensions de la personne : la relation aux autres, à soi-même et au monde. Il s’agit d’un triple renoncement : des affections, de la vie et des biens.
Pourquoi Jésus propose-t-il ces exigences à ses disciples ? Pour les rendre libres ! Tout attachement peut devenir une forme d’esclavage. En y réfléchissant bien, Jésus ne fait qu’inviter à anticiper volontairement ce que la vie se chargera de faire tôt ou tard : nous dépouiller de notre famille, de nos forces, de nos projets, de nos rêves, et de nos biens. Au fond, il s’agit de vivre ce que saint Paul disait à la communauté de Corinthe : ceux qui ont une femme, qu’ils vivent comme s’ils ne l’avaient pas ; ceux qui usent des biens de ce monde, comme s’ils n’en usaient pas (cf. 1 Co 7,29-31).
Pour appuyer cet enseignement, Jésus raconte deux brèves paraboles : celle de l’homme qui veut construire une tour et celle du roi qui se prépare à affronter une guerre. Tous deux doivent d’abord s’asseoir, réfléchir et calculer s’ils ont les moyens de mener à bien leur entreprise. De la même manière, le chrétien qui veut construire sa vie (cf. 1 Co 3,12-15) ou mener le combat spirituel (cf. 2 Tm 4,7), ne peut être ni superficiel ni approximatif, au risque de rater misérablement le sens même de son existence.
Quelle sera notre réaction face à cette Parole de Jésus ?
Peut-être sommes-nous trop habitués à l’entendre pour en mesurer réellement le poids. Ou bien pensons-nous que ces paroles ne s’adressent qu’à quelques élus, appelés à une vocation de consécration spéciale. Mais ce n’est pas le cas ! Il n’y a pas de chrétiens de première ou de seconde classe. Cette exigence concerne tous ceux qui désirent être disciples de Jésus.
Pauvres de nous, prêtres et prédicateurs, appelés à commenter cet Évangile ! La tentation est grande : abaisser la barre pour ne pas troubler nos assemblées. Et au fond, quel exemple donnons-nous, nous-mêmes, dans la mise en pratique concrète de cette Parole ?
Que nous serve d’encouragement ce qu’écrivait Origène — écrivain ecclésiastique des IIe-IIIe siècles, l’une des grandes figures intellectuelles de l’histoire de l’Église :
« Je ne veux pas ajouter au péché de ne pas l’accomplir, le péché de ne pas le dire. »
P. Manuel João Pereira Correia, mccj
REALISME RESPONSABLE
Luc 14,25-33
Les exemples utilisés par Jesús sont très différents, mais son enseignement est le même: celui qui entreprend un projet important de façon téméraire, sans vérifier à l’avance s’il dispose des moyens et des forces pour atteindre son objectif, risque d’échouer. Aucun paysan ne se lance dans la construction d’une tour de garde pour ses vignobles, sans prendre auparavant un temps pour calculer s’il pourra y arriver avec succès, de peur que le bâtiment ne reste inachevé, provoquant les moqueries des voisins. Aucun roi ne décide d’attaquer un adversaire puissant, sans analyser auparavant si une telle bataille pourra finir en victoire ou si elle deviendra un suicide.
On peut penser, à première vue, que Jésus nous invite à un comportement prudent et prévoyant, très éloigné de l’audace dont il fait montre souvent pour parler aux siens. Rien n’est plus loin de la réalité. La mission qu’il veut confier aux siens est tellement importante que personne ne doit s’y engager de façon inconsciente, téméraire ou présomptueuse.
Son avertissement revêt une grande actualité en ces moments critiques et décisifs pour l’avenir de notre foi. Jésus appelle, avant tout, à une réflexion mature: les deux protagonistes de ces paraboles «s’assoient» pour réfléchir. Ce serait une grave irresponsabilité que de vivre aujourd’hui en disciples de Jésus qui ne savent pas ce qu’ils veulent ni où ils prétendent aller, ni avec quels moyens ils comptent travailler.
Quand allons-nous nous asseoir pour unifier nos forces, réfléchir et chercher ensemble le chemin à suivre? N’avons-nous pas besoin d’y consacrer plus de temps, plus d’écoute de l’évangile et plus de méditation afin de découvrir les appels, éveiller les charismes et suivre Jésus d’une manière renouvellée?
Jesús appelle aussi au réalisme. Nous sommes en train de vivre un changement socioculturel sans précédents. Est-il possible de communiquer la foi en ce nouveau monde qui est en train de naître, sans bien le connaître et sans le comprendre de l’intérieur? Est-il possible de faciliter l’accès à l’Evangile en ignorant la pensée, les sentiments et le langage des hommes et des femmes de notre temps? N’est- ce pas une erreur que de répondre aux défis d’aujourd’hui avec des stratégies d’hier?
Agir, en ces temps, de façon inconsciente et aveugle, serait de la témérité. Ce serait s’exposer à l’échec, à la frustration et même au ridicule. D’après la parabole, la «tour inachevée» ne fait que provoquer les moqueries des gens envers le constructeur. Il ne faut pas oublier le langage réaliste et humble de Jésus invitant ses disciples à être «ferment» au milieu du peuple ou un peu de «sel» qui donne une nouvelle saveur à la vie des gens.
José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna
La passion selon Amélie
Lors d’un Vendredi Saint où j’avais invité le moine bénédictin, Jean-Yves Quellec, à célébrer l’office dans mon prieuré, il a ouvert la liturgie par cette question : « Quoi de plus extérieur, de plus rude, de plus étroit qu’une Croix ? Toute la passion du monde au croisement de deux bois. »
Pourquoi faut-il que, nous aussi, nous portions ces deux bois pour suivre Jésus ? N’est-ce pas ici que, souvent, les routes se séparent avec bien des contemporains ? Des amis laïques, athées, agnostiques, mais chrétiens également, tous hommes et femmes de bonne volonté et prêts à un bout de chemin évangélique s’arrêtent à cet endroit précis. Le Jésus de la fraternité et du partage du pain, oui, peut-être. Mais cet homme bafoué, « sans éclat ni beauté » (Is 35,2), ça non ! L’exaltation de la Croix est d’un imbuvable dolorisme.
Jean-Yves Quellec leur donne raison ! Ne regardons pas la Croix dans un sens qu’elle n’a pas. Jésus a d’abord crié sa souffrance. Il a lutté contre elle, de toutes ses forces. Il a guéri, tant qu’il a pu, jusqu’à l’épuisement. Et quand l’heure fut venue de rejoindre le plus noir du monde, « il s’est dévasté lui-même » pour que les plus blessés, les plus défigurés sachent que la fraternité existe jusqu’au fond de l’enfer.
Alors, porter sa croix pour marcher à sa suite, ce n’est pas chercher la souffrance, ni la sublimer, ni la transfigurer, mais rejoindre les obscurs bas-fonds où l’abandonné se désole, et se pencher sur l’abîme pour lui tendre la main.
Si on m’avait dit qu’un jour Amélie Nothomb s’aventurerait sur ce chemin-là… Hé bien si ! Et pas qu’un peu. Une vraie, une authentique, une bouleversante, une impertinente relecture de la Passion… racontée par Jésus lui-même (1). Bien sûr, c’est un roman. Mais justement, ne sont-ce pas les imaginations romancières qui osent interroger les traditions les plus établies ? Et il fallait oser lui donner cette parole-là, à ce Jésus-en-je, qui de la flagellation à la crucifixion, confie ce que lui a vraiment vécu et que les Évangiles n’ont pas toujours compris !
Que le récit soit décapant, c’est peu dire. Et que Jésus déteste la Croix, ce n’est pas surprenant. Même des lectures « spirituelles » comme celle de Jean-Yves Quellec vont dans ce sens. Mais Amélie aggrave en imaginant que Jésus a pu vouloir ce « supplice public » et que ça, il n’arrive pas à se le pardonner. Et il dit ça à dessein : « Ce que je vis est laid et grossier. Si au moins je pouvais compter sur le rapide oubli des peuples ! Ce qui m’écrase le plus est de savoir qu’on va en parler pour les siècles des siècles, et pas pour décrier mon sort. Aucune souffrance humaine ne fera l’objet d’une aussi colossale glorification. On va me remercier pour ça. On va m’admirer pour ça. On va croire en moi pour ça. »
Je ne suis pas sûr qu’Amélie Nothomb soit très éloignée de Jean-Yves Quellec quand elle écrit ça.
Cette Passion selon Amélie offre – vraiment ! – une relecture surprenante du récit évangélique. Et qu’importe que ce ne soit pas là le souci de la romancière. Moi, je suis très touché de ce qu’elle dit de « tomber ». J’admire son portrait de Simon de Cyrène (« Il y a des gens comme ça. Ils ignorent lseur propre rareté »), son regard sur Véronique, sur Marie, sur Marie-Madeleine… et je suis particulièrement ému par ses pages vraiment étonnantes quand elle parle de « l’après ». « Mourir,écrit-elle, c’est faire acte de présence par excellence. » Et un peu plus loin : « Si vous aimez vos morts, faites-leur confiance au point d’aimer leur silence. »
Je n’ai rien dit de la Soif qui donne son titre au roman. Il en est question tout au long du livre. Une magnifique exploration du « j’ai soif », où Amélie entraîne son lecteur en pays mystique. « Il y a des gens qui pensent ne pas être des mystiques. Ils se trompent. Il suffit d’avoir crevé de soif un moment pour accéder à ce statut. Et l’instant ineffable où l’assoiffé porte à ses lèvres un gobelet d’eau, c’est Dieu. »
Dans « Soif », Amélie Nothomb explore l’esprit de Jésus, « le plus incarné des humains »
Gabriel Ringlet