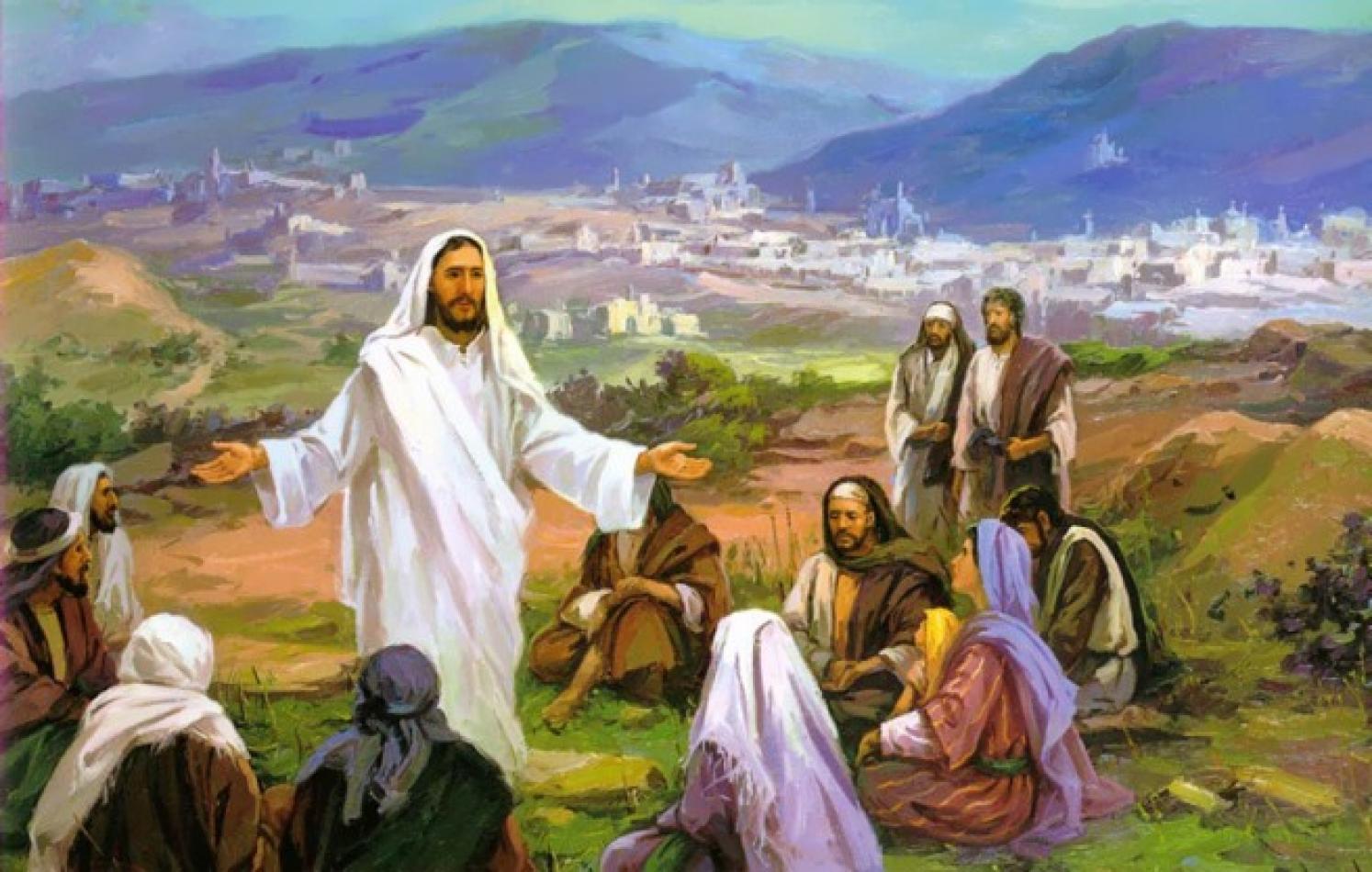Daniel Comboni
Missionnaires Comboniens
Zone institutionnelle
D’autres liens
Newsletter
Aujourd’hui, deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons… la « Pâque de saint Thomas », l’apôtre qui était absent de la communauté apostolique dimanche dernier ! Ce dimanche est aussi appelé le « Dimanche de la Divine Miséricorde », depuis le 30 avril 2011, jour de la canonisation de sœur Faustine par le pape Jean-Paul II. Alors que nous louons le Seigneur pour sa miséricorde, nous le remercions d’une manière toute spéciale pour le don du pape François qui a fait de la miséricorde un des « leitmotiv » de son pontificat.
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jean 20,19-31
Aujourd’hui, deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons… la « Pâque de saint Thomas », l’apôtre qui était absent de la communauté apostolique dimanche dernier ! Ce dimanche est aussi appelé le « Dimanche de la Divine Miséricorde », depuis le 30 avril 2011, jour de la canonisation de sœur Faustine par le pape Jean-Paul II. Alors que nous louons le Seigneur pour sa miséricorde, nous le remercions d’une manière toute spéciale pour le don du pape François qui a fait de la miséricorde un des « leitmotiv » de son pontificat.
Les thèmes que l’évangile nous propose sont cependant nombreux : le dimanche (« le premier jour de la semaine ») ; la Paix du Ressuscité et la joie des apôtres ; la « Pentecôte » et la Mission des apôtres (selon l’évangile de Jean) ; le don et la mission confiée aux apôtres de pardonner les péchés (raison pour laquelle nous célébrons aujourd’hui le « Dimanche de la Divine Miséricorde ») ; le thème de la communauté (dont Thomas s’était absenté !) ; mais surtout le thème de la foi ! Je me limiterai à m’arrêter sur la figure de Thomas.
Thomas, notre jumeau
Son nom signifie « double » ou « jumeau ». Thomas occupe une place importante parmi les apôtres : peut-être pour cette raison lui ont été attribués les Actes et l’Évangile de Thomas, apocryphes du IVe siècle, « importants pour l’étude des origines chrétiennes » (Benoît XVI, 27.09.2006).
Nous aimerions savoir de qui Thomas est le jumeau. Il pourrait s’agir de Nathanaël (Barthélemy). En effet, cette dernière profession de foi, faite par Thomas, correspond à la première, faite par Nathanaël, au début de l’évangile de Jean (1,45-51). De plus, leur caractère et leur comportement sont étonnamment similaires. Enfin, les deux noms apparaissent relativement proches dans la liste des Douze (voir Matthieu 10,3 ; Actes 1,13 ; et aussi Jean 21,2).
Cette incertitude nous permet d’affirmer que Thomas est « le jumeau de chacun de nous » (Don Tonino Bello). Thomas nous réconforte dans nos doutes de croyants. En lui, nous nous reflétons et, à travers ses yeux et ses mains, nous aussi « voyons » et « touchons » le corps du Ressuscité. Une interprétation pleine de charme !...
Thomas, un « double » ?
Dans la Bible, le couple de jumeaux le plus célèbre est celui d’Ésaü et Jacob (Genèse 25,24-28), éternels antagonistes, expression de la dichotomie et de la polarité de la condition humaine. Ne serait-ce pas que Thomas (le « double » !) porte en lui l’antagonisme de cette dualité ? Capable, parfois, de gestes de grande générosité et de courage, alors qu’à d’autres moments, il se montre incrédule et entêté. Mais, confronté au Maître, sa profonde identité de croyant qui proclame la foi avec promptitude et conviction ressurgit.
Thomas porte en lui son « jumeau ». L’évangile apocryphe de Thomas souligne cette duplicité : « Vous étiez un, mais vous êtes devenus deux » (n° 11) ; « Jésus dit : Quand vous ferez de deux un, alors vous deviendrez fils d’Adam » (n° 105). Thomas est l’image de nous tous. Nous portons nous aussi en nous ce « jumeau », inflexible et ardent défenseur de ses idées, obstiné et capricieux dans ses comportements.
Ces deux réalités ou « créatures » (l’ancien et le nouvel Adam) coexistent mal, en opposition, parfois en guerre ouverte, dans notre cœur. Qui n’a jamais ressenti la souffrance de cette déchirure intérieure ?
Eh bien, Thomas a le courage d’affronter cette réalité. Il permet à son côté obscur, adverse et incrédule, de se manifester, et il le confronte à Jésus. Il accepte le défi lancé par son intériorité « rebelle » qui demande à voir et à toucher… Il l’amène à Jésus et, devant l’évidence, le « miracle » se produit. Les deux « Thomas » deviennent un seul et proclament la même foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Malheureusement, ce n’est pas ce qui se passe chez nous. Nos communautés chrétiennes sont fréquentées presque exclusivement par des « jumeaux bons » et soumis, mais aussi… passifs et amorphes ! Le fait est qu’ils ne sont pas là dans leur « totalité ». La part énergique, instinctive, l’autre jumeau, celle qui aurait besoin d’être évangélisée, n’apparaît pas à la « rencontre » avec le Christ.
Jésus a dit qu’il était venu pour les pécheurs, mais on dirait que nos églises sont fréquentées par des « justes » qui… ne ressentent pas le besoin de se convertir ! Celui qui devrait se convertir, l’autre jumeau, le « pécheur », nous le laissons tranquillement à la maison. C’est dimanche, il en profite pour « se reposer » et confie la journée au « bon jumeau ». Le lundi, alors, le jumeau des instincts et des passions sera en pleine forme pour reprendre les commandes.
Jésus à la recherche de Thomas
Ah ! Si Jésus avait beaucoup de Thomas ! Dans la célébration dominicale, c’est surtout d’eux que le Seigneur est à la recherche… Seraient-ils ses « jumeaux » ? Dieu cherche des hommes et des femmes « réels », qui se rapportent à lui tels qu’ils sont : des pécheurs qui souffrent dans leur chair de la tyrannie des instincts. Des croyants qui ne craignent pas d’apparaître avec cette part incrédule et résistante à la grâce. Qui ne viennent pas pour faire bonne figure dans « l’assemblée des croyants », mais pour rencontrer le Médecin de la Divine Miséricorde et être guéris. C’est de ceux-là que Jésus se fait frère !
Le monde a besoin du témoignage de croyants honnêtes, capables de reconnaître leurs erreurs, leurs doutes et leurs difficultés, et qui ne cachent pas leur « duplicité » derrière une façade de « respectabilité » pharisaïque. La mission a vraiment besoin de disciples qui soient des personnes authentiques et non pas « au cou raide » ! Des chrétiens qui regardent en face la réalité de la souffrance et qui touchent de leurs mains les plaies des crucifiés d’aujourd’hui !...
Thomas nous invite à réconcilier notre duplicité pour faire Pâques !
Parole de Jésus, selon l’Évangile de Thomas (n° 22 et n° 27) : « Quand vous ferez en sorte que deux soient un, que l’intérieur soit comme l’extérieur et l’extérieur comme l’intérieur, que le haut soit comme le bas, et quand vous ferez de l’homme et de la femme une seule chose (…) alors vous entrerez dans le Royaume ! »
P. Manuel João Pereira Correia, mccj
Entrer dans ses plaies
Jean 20, 19-31
Pape François
Dans l’Evangile de ce jour, le verbe voir revient plusieurs fois : « Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur » (Jn 20, 20). Ils dirent ensuite à Thomas : « Nous avons vu le Seigneur » (v.25). Mais l’Evangile ne décrit pas comment ils l’ont vu, il ne décrit pas le Ressuscité, il met seulement en évidence un détail : « Il leur montra ses mains et son côté » (v. 20). L’Evangile semble vouloir nous dire que les disciples ont reconnu Jésus ainsi : par ses plaies. La même chose est arrivée à Thomas : lui aussi voulait voir « dans ses mains la marque des clous » (v. 25) et croire après avoir vu (v. 27).
Malgré son incrédulité, nous devons remercier Thomas car il ne s’est pas contenté d’entendre dire par les autres que Jésus était vivant, ni même de le voir en chair et en os ; mais il a voulu voir dedans, toucher de la main ses plaies, les signes de son amour. L’Evangile appelle Thomas « Didyme » (v. 24), ce qui veut dire jumeau, et, en cela, il est vraiment notre frère jumeau. Car il ne nous suffit pas non plus de savoir que Dieu existe : un Dieu ressuscité mais lointain ne remplit pas notre vie ; un Dieu distant ne nous attire pas, même s’il est juste et saint. Non, nous avons besoin, nous aussi, de “voir Dieu”, de toucher de la main qu’il est ressuscité, et ressuscité pour nous.
Comment pouvons-nous le voir ? Comme les disciples : à travers ses plaies. En regardant ces plaies, ils ont compris qu’il ne les aimait pas pour plaisanter et qu’il les pardonnait même s’il y en avait un parmi eux qui l’avait renié et qui l’avait abandonné. Entrer dans ses plaies, c’est contempler l’amour démesuré qui déborde de son cœur. Voilà le chemin ! C’est comprendre que son cœur bat pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Chers frères et sœurs, nous pouvons nous estimer et nous dire chrétiens, et parler de nombreuses belles valeurs de la foi, mais, comme les disciples, nous avons besoin de voir Jésus en touchant son amour. C’est seulement ainsi que nous allons au cœur de la foi et, comme les disciples, nous trouvons une paix et une joie (cf. vv. 19-20) plus fortes que tout doute.
Thomas s’est exclamé après avoir vu les plaies du Seigneur : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (v. 28). Je voudrais attirer l’attention sur cet adjectif que Thomas répète : mon. C’est un adjectif possessif et, si nous y réfléchissons bien, il pourrait sembler déplacé de le référer à Dieu : Comment Dieu peut-il être à moi ? Comment puis-je faire mien le Tout Puissant ? En réalité, en disant mon nous ne profanons pas Dieu, mais nous honorons sa miséricorde, parce que c’est lui qui a voulu se “faire nôtre”. Et nous lui disons, comme dans une histoire d’amour : “Tu t’es fait homme pour moi, tu es mort et ressuscité pour moi, et donc tu n’es pas seulement Dieu, tu es mon Dieu, tu es ma vie. En toi j’ai trouvé l’amour que je cherchais, et beaucoup plus, comme jamais je ne l’aurais imaginé”.
Dieu ne s’offense pas d’être “nôtre”, car l’amour demande de la familiarité, la miséricorde demande de la confiance. Déjà, au début des dix commandements, Dieu disait : « Je suis le Seigneur ton Dieu » (Ex 20, 2) et il confirmait : « Moi le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux » (v. 5). Voilà la proposition de Dieu, amoureux jaloux qui se présente comme ton Dieu. Et du cœur ému de Thomas jaillit la réponse : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». En entrant aujourd’hui, à travers les plaies, dans le mystère de Dieu, nous comprenons que la miséricorde n’est pas une de ses qualités parmi les autres, mais le battement de son cœur même. Et alors, comme Thomas, nous ne vivons plus comme des disciples hésitants, dévots mais titubants ; nous devenons, nous aussi, de vrais amoureux du Seigneur ! Nous ne devons pas avoir peur de ce mot : amoureux du Seigneur.
Comment savourer cet amour, comment toucher aujourd’hui de la main la miséricorde de Jésus ? C’est encore l’Evangile qui nous le suggère lorsqu’il souligne que, le soir même de Pâques (cf. v. 19), c’est-à-dire à peine ressuscité, Jésus, avant toute chose, donne l’Esprit pour pardonner les péchés. Pour faire l’expérience de l’amour, il faut passer par là : se laisser pardonner. Se laisser pardonner. Je me demande, ainsi qu’à chacun d’entre vous : est-ce que moi, je me laisse pardonner ? Pour faire l’expérience de cet amour, il faut passer par là. Est-ce que je me laisser pardonner, moi ? ‘‘Mais, mon Père, aller se confesser semble difficile…’’. Face à Dieu, nous sommes tentés de faire comme les disciples dans l’Evangile : nous barricader, les portes fermées. Ils le faisaient par crainte, et, nous aussi, nous avons peur, honte de nous ouvrir et de dire nos péchés. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre la honte, de la voir non pas comme une porte fermée, mais comme le premier pas de la rencontre. Quand nous éprouvons de la honte, nous devons être reconnaissants : cela veut dire que nous n’acceptons pas le mal, et cela est bon. La honte est une invitation secrète de l’âme qui a besoin du Seigneur pour vaincre le mal. Le drame c’est quand on n’a plus honte de rien. N’ayons pas peur d’éprouver de la honte ! Et passons de la honte au pardon ! N’ayez pas peur d’éprouver de la honte ! N’ayez pas peur !
Il y a, en revanche, une porte fermée face au pardon du Seigneur, celle de la résignation. La résignation est toujours une porte fermée. Les disciples en ont fait l’expérience qui, à Pâques, constataient amèrement que tout était redevenu comme avant : ils étaient encore là, à Jérusalem, découragés ; le “chapitre Jésus” semblait clos, et après tant de temps passé avec lui, rien n’avait changé ; résignons-nous ! Nous aussi nous pouvons penser : “Je suis chrétien depuis si longtemps, et pourtant rien ne change en moi, je commets toujours les mêmes péchés”.
Alors, découragés, nous renonçons à la miséricorde. Mais le Seigneur nous interpelle : “Ne crois-tu pas que ma miséricorde est plus grande que ta misère ? Tu récidives en péchant ? Récidive en demandant la miséricorde, et nous verrons qui l’emportera ! ” Et puis – celui qui connaît le Sacrement du pardon le sait – il n’est pas vrai que tout reste comme avant. A chaque pardon nous sommes ragaillardis, encouragés, car nous nous sentons à chaque fois plus aimés, davantage embrassés par le Père. Et quand, aimés, nous retombons, nous éprouvons davantage de souffrance qu’avant. C’est une souffrance bénéfique qui lentement nous éloigne du péché. Nous découvrons alors que la force de la vie, c’est de recevoir le pardon de Dieu et d’aller de l’avant, de pardon en pardon. Ainsi va la vie : de honte en honte, de pardon en pardon. C’est cela la vie chrétienne !
Après la honte et la résignation, il y a une autre porte fermée, blindée parfois : notre péché, le même péché. Quand je commets un gros péché, si moi, en toute honnêteté, je ne veux pas me pardonner, pourquoi Dieu devrait-il le faire ? Mais cette porte est verrouillée seulement d’un côté, le nôtre ; pour Dieu elle n’est jamais infranchissable. Comme nous l’apprend l’Evangile, il aime, justement, entrer “les portes étant fermées” – nous l’avons entendu –, quand tout passage semble barré. Là, Dieu fait des merveilles. Il ne décide jamais de se séparer de nous, c’est nous qui le laissons dehors. Mais quand nous nous confessons il se produit une chose inouïe : nous découvrons que précisément ce péché qui nous tenait à distance du Seigneur devient le lieu de la rencontre avec lui. Là, le Dieu blessé d’amour vient à la rencontre de nos blessures. Et il rend nos misérables plaies semblables à ses plaies glorieuses. Il y a une transformation : ma misérable plaie ressemble à ses plaies glorieuses. Car il est miséricorde et fait des merveilles dans nos misères. Comme Thomas, demandons aujourd’hui la grâce de reconnaître notre Dieu : de trouver dans son pardon notre joie, de trouver dans sa miséricorde notre espérance.