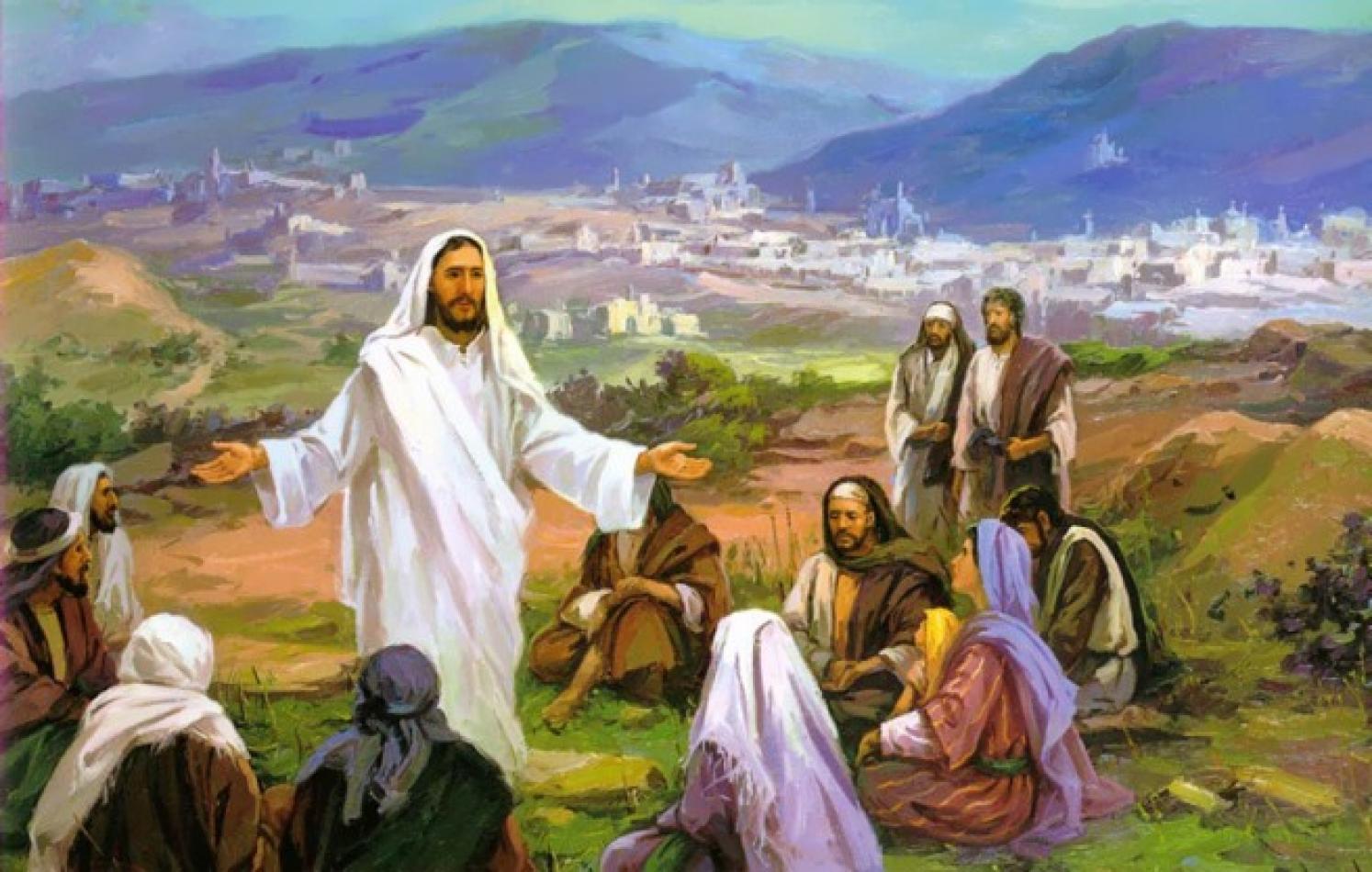Daniel Comboni
Missionnaires Comboniens
Zone institutionnelle
D’autres liens
Newsletter
Trois textes évangéliques parlent de Marthe et Marie : Luc 10,38-42 ; Jean 11,1-46 et 12,1-8. Nous concentrerons surtout notre attention sur le récit de Luc. La tradition voit en Marthe le symbole de la vie active et en Marie celui de la vie spirituelle ou contemplative, considérée comme supérieure. Le « service corporel » serait inférieur au « service spirituel » (saint Basile).
MARTHE et MARIE
Action ou prière ? Épouser… les deux sœurs !
La tradition voit en Marthe le symbole de la vie active et en Marie celui de la vie spirituelle ou contemplative, considérée comme supérieure. Le « service corporel » serait inférieur au « service spirituel » (saint Basile). Tandis que la vie active s’achève avec ce monde, la vie contemplative continue dans l’au-delà – dit saint Grégoire le Grand. Mais il ajoute qu’il faut « épouser » les deux, comme Jacob qui, bien qu’il préfère Rachel (plus belle mais stérile), doit d’abord épouser Léa (moins séduisante mais féconde).
Trois textes évangéliques parlent de Marthe et Marie : Luc 10,38-42 ; Jean 11,1-46 et 12,1-8. Nous concentrerons surtout notre attention sur le récit de Luc.
Selon le quatrième Évangile, les deux sœurs habitaient à Béthanie, un village des environs de Jérusalem. Saint Jean les mentionne toujours ensemble avec leur frère Lazare. Il semble s’agir d’une famille aisée. Amis de Jésus, ils l’accueillent avec son entourage (une trentaine de personnes ?) lorsqu’il se rend à Jérusalem. Là, Jésus peut se reposer et trouver « où reposer sa tête » (Matthieu 8,20). Béthanie est le « sanctuaire » de l’amitié et de l’hospitalité.
Marthe semble être l’aînée et la maîtresse de maison. Son nom signifie probablement « maîtresse / dame de maison ». Ce nom est masculin chez les Nabatéens, et dans le Talmud il peut être masculin ou féminin. C’est une femme dynamique et active.
Marie semble plus jeune, plus tendre et introvertie. L’étymologie de son nom est incertaine : « rebelle », « aimée », « élevée »…
Selon Luc 10,38-42, Marthe et Marie accueillent Jésus chez elles. Tandis que Marthe s’affaire à préparer le repas pour les invités, Marie reste aux pieds de Jésus pour l’écouter. Agacée, Marthe demande à Jésus de dire à sa sœur de l’aider. Jésus répond de manière inattendue :
« Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. »
Cette phrase de Jésus a fait l’objet de nombreuses interprétations, parfois tendancieuses ou idéologiques. Mais elle peut nous aider à méditer sur notre vocation de disciples de Jésus.
Soumission ou émancipation ?
UNE VISION RÉVOLUTIONNAIRE DE LA FEMME
L’attitude de Marie, affectueuse, dévouée, silencieuse, a été exaltée par une certaine tendance machiste et cléricale, favorable à la soumission de la femme à l’homme. Marthe, au contraire, une femme qui a le courage de « prendre la parole » et d’affirmer sa propre individualité, serait un symbole de l’émancipation féminine. Dans certaines peintures médiévales, elle est représentée comme l’équivalent féminin de saint Georges ou saint Michel, avec la particularité qu’elle ne tue pas le dragon mais le dompte, le tenant en laisse comme un animal domestique. C’est une manière différente, féminine, de dominer le mal : non pas en supprimant l’adversaire, mais en le rendant docile.
En réalité, la figure de Marie est elle aussi révolutionnaire. Être aux pieds de quelqu’un signifiait en être le disciple. Or, à l’époque de Jésus, l’étude de la Torah (la Loi) était réservée aux hommes. En hébreu et en araméen, le mot « disciple » n’a pas de féminin. Ainsi, en louant l’attitude de Marie, Jésus adopte une position provocante, rejetant la mentalité patriarcale. Il discrédite en quelque sorte la « femme exemplaire » traditionnelle représentée par Marthe, préoccupée par les tâches domestiques (voir Proverbes 31,10ss).
Ainsi, toutes deux représentent une forme d’émancipation féminine : Marthe avec son extraversion entreprenante, Marie avec son intériorité silencieuse. Elles forment le modèle d’une humanité intégrée où silence et parole, introversion et extraversion cohabitent.
Action ou prière ?
ÉPOUSER… LES DEUX SŒURS !
La tradition voit en Marthe le symbole de la vie active et en Marie celui de la vie spirituelle ou contemplative, considérée comme supérieure. Le « service corporel » serait inférieur au « service spirituel » (saint Basile). Tandis que la vie active s’achève avec ce monde, la vie contemplative continue dans l’au-delà – dit saint Grégoire le Grand. Mais il ajoute qu’il faut « épouser » les deux, comme Jacob qui, bien qu’il préfère Rachel (plus belle mais stérile), doit d’abord épouser Léa (moins séduisante mais féconde).
En réalité, l’opposition entre vie active et contemplative est fausse : l’une ne peut exister sans l’autre. Elles ne s’excluent pas mais se complètent. Il s’agit de deux dimensions essentielles de la vocation du disciple. Marthe et Marie sont unies, comme le souligne saint Jean qui les mentionne toujours ensemble. Jésus aime les deux (Jean 11,5). En fait, c’est Marthe qui court à la rencontre de Jésus (tandis que Marie reste à la maison) et qui fait une magnifique profession de foi (Jean 11,20.27). Marthe et Marie ne sont pas des figures opposées, mais complémentaires. Nous sommes tous appelés à incarner Marthe et Marie, à être serviteurs et auditeurs de la Parole.
Les deux sœurs vivent réconciliées. C’est ainsi que le peintre dominicain Fra Angelico les représente dans une fresque (à Florence). Toutes deux assistent (spirituellement) à l’agonie de Jésus au jardin. Tandis que les trois disciples dorment, elles veillent, pénétrées du mystère. Marie lit la Parole, Marthe l’écoute avec attention et tendresse. Les deux « épouses » cohabitent en paix.
Loi ou Évangile ?
UNE ÉGLISE EN ROBE NUZIALE ET AVEC LE TABLIER !
On peut aussi supposer que Luc, en présentant ces deux figures stylisées, voulait montrer deux types de service dans la communauté chrétienne : le « service des tables » (diaconie) et le service de la Parole (prophétie). Confrontés à ces deux services, les apôtres doivent à un moment donné faire un choix : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables » (Actes 6,2). Le service de la Parole serait supérieur à celui de la charité.
Pour certains, Marthe et Marie symboliseraient deux phases du chemin de foi. Marthe, préoccupée par « faire beaucoup de choses », représenterait la « première conversion », celle de la purification des œuvres. Marie, centrée sur « l’unique nécessaire », incarnerait la « seconde conversion », celle de la purification du cœur. Dans ce cas, Marthe représenterait l’Ancien Testament (la Torah avec ses 613 commandements), et Marie le Nouveau (avec la « Loi de l’Amour » qui les unifie).
En réalité, elles représentent deux dimensions essentielles et également importantes de l’Épouse (l’Église) qui s’identifie avec son Époux « venu pour servir » (Marc 10,45). C’est-à-dire : la communauté chrétienne, resplendissante dans sa robe nuptiale, « assise à la droite du Roi » (Psaume 44,14), mais aussi capable d’enlever ses vêtements pour revêtir le tablier du service et laver les pieds de ses enfants (Jean 13,4).
Faire ou Être ?
LE DOUBLE COMMANDEMENT DE L’AMOUR
Le contexte de l’épisode de Béthanie est éloquent. D’un côté, il est précédé par la parabole du « bon samaritain », qui se termine par : « Va, et TOI AUSSI, FAIS de même » (Luc 10,37). De l’autre, il est suivi immédiatement par l’enseignement de Jésus sur le Notre Père et la prière (Luc 11,1-10). On dirait que Luc veut souligner l’unité entre l’action (« se faire prochain » du frère) et l’écoute de la Parole (« être proche » de Dieu).
Si le « bon samaritain » est une icône de l’amour du prochain, Béthanie l’est de l’amour de Dieu. Marthe « fait », Marie « aime ». L’épisode de l’onction à Béthanie raconté par saint Jean confirme cette relecture. Jésus défend Marie contre Judas, qui invoque la charité envers les pauvres pour la critiquer (Jean 12,8).
Conclusion ?
CONVERSION ET DISCERNEMENT
Marthe et Marie apparaissent toujours « à la maison ». La maison et le village sont le temps de la vie ordinaire, l’“Église domestique”. La condition normale du chrétien, du laïc. Au centre se trouvent l’écoute de la Parole et le Service. Il s’agit de faire de notre maison une « Béthanie ». Accueillir l’Ami Jésus. Accueillir une personne chez soi change nos priorités et notre manière de faire les choses !
Marthe et Marie aiment toutes deux Jésus, mais elles ont des priorités différentes. Marie concentre son attention sur Jésus et se réjouit de sa présence. Marthe, préoccupée par les tâches, cède à l’inquiétude, à l’impatience et à la fatigue. Et la présence de Jésus finit par devenir pour elle un « fardeau ». Voilà le problème.
L’irritation de Marthe pousse Jésus à l’« appeler » avec tendresse (c’est le sens de la répétition du nom : « Marthe, Marthe ») pour la ramener à l’essentiel, à la conversion vers « l’unique nécessaire », à la recherche du Royaume de Dieu. Tout le reste viendra par surcroît (Luc 12,31).
Le temps presse, et le disciple ne peut se soucier de « trop de choses ». La multiplicité des services n’est pas nécessairement synonyme du « service » que Jésus attend de lui. Il faut donc établir des priorités et des urgences. En d’autres termes, il faut discerner. Comme le dit Paul :
« Et voici ma prière : que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour discerner ce qui est le meilleur » (Philippiens 1,9-10).
P. Manuel João Pereira Correia, mccj
« Tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses ! »
« Une femme nommée Marthe le reçut. »
Luc 10,38-42
Après la parabole du bon Samaritain proposée dimanche dernier, la liturgie nous présente aujourd’hui l’épisode de l’hospitalité offerte par deux sœurs, Marthe et Marie de Béthanie. Le contexte de l’épisode de Béthanie est très éloquent. D’un côté, il est précédé de la parabole du « bon Samaritain », qui se termine par : « Va, et toi aussi, fais de même » (Luc 10,37). De l’autre, il est immédiatement suivi de l’enseignement de Jésus sur le Notre Père et sur la prière (Luc 11,1-10). Il est clair que Luc veut souligner l’unité entre l’Action (« se faire prochain » du frère) et l’Écoute de la Parole (« être proche » de Dieu).
Dans la première lecture, Abraham accueille Dieu qui se manifeste sous la forme mystérieuse de trois hommes : « Ayant levé les yeux, il vit trois hommes debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de sa tente et se prosterna jusqu’à terre, disant : ‘Mon Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter chez ton serviteur’ » (cf. Genèse 18,1-10).
On peut affirmer que l’hospitalité constitue le thème central de la Parole de ce dimanche. L’hospitalité est l’une des grandes métaphores de la vie. Accueillis dans le sein maternel, dans une famille et une société, nous sommes éduqués à devenir, à notre tour, accueillants/proches envers les autres et envers toute vie.
L’Écriture est une histoire d’accueils, depuis notre entrée dans le paradis terrestre (Genèse), jusqu’à notre accueil dans le Paradis céleste (Apocalypse 21–22), dans la nouvelle Jérusalem, dont « les portes ne se fermeront jamais » (21,25). Là s’accomplira l’accueil parfait et total : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux » (21,3). Au cœur de l’histoire, nous trouvons le Verbe fait chair, qui « est venu habiter parmi nous » (Jean 1,14). Rejeté, Il n’a pas renoncé, mais depuis lors Il continue de frapper à la porte de chaque cœur humain (cf. Apocalypse 3,20).
Mais que signifie l’accueil dans la vie chrétienne ? C’est ce que saint Luc veut nous faire comprendre à travers cet épisode que l’on ne trouve que dans son Évangile.
Deux femmes : une icône de l’hospitalité
Qui sont les deux sœurs, Marthe et Marie ? Marthe semble être l’aînée et la maîtresse de maison. C’est une femme active et énergique. Marie, en revanche, apparaît plus jeune, plus douce, plus réfléchie.
Selon Luc 10,38-42, Marthe et Marie accueillent Jésus dans leur maison. Il n’est pas fait mention de leur frère Lazare, qui dans l’Évangile de Jean est toujours lié aux deux sœurs. Il n’est pas non plus question du groupe nombreux qui accompagnait Jésus. L’évangéliste met intentionnellement l’accent sur les deux sœurs et leur attitude envers Jésus. Tandis que Marthe s’affaire à préparer le repas, Marie s’assoit aux pieds de Jésus pour L’écouter. Agacée, Marthe demande à Jésus de lui dire de l’aider. Jésus répond de manière inattendue : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses ; une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée ».
Cette parole de Jésus a fait l’objet de nombreuses interprétations, comme s’il s’agissait d’une supériorité supposée de la vie contemplative sur la vie active, ou de la prière sur l’action. Le « service corporel » serait inférieur au « service spirituel », selon saint Basile. Mais ce n’est certainement pas l’intention de Jésus. Prière et action sont indissociables. Elles ne s’excluent pas, ne s’opposent pas, mais se complètent. Il s’agit de souligner les deux dimensions essentielles de la vocation du disciple. Marthe et Marie ne sont pas des figures opposées, mais complémentaires. Nous sommes tous appelés à incarner Marthe et Marie, à être à la fois serviteurs et auditeurs de la Parole. Que veut donc dire Jésus ?
L’accueil comme écoute
« Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. »
Remarquons d’abord le caractère inédit et provocateur de la scène. Jésus brise les conventions sociales en acceptant l’invitation de femmes, chose mal vue à son époque. De plus, Marie adopte une posture révolutionnaire. Être assis aux pieds d’un rabbin signifiait être son disciple. Or, à l’époque de Jésus, l’étude de la Torah était réservée aux hommes. « Il vaut mieux brûler la Torah que de la remettre entre les mains d’une femme », disaient les rabbins (bibliste F. Armellini). Même saint Paul était encore marqué par cette mentalité culturelle, comme en témoignent ses recommandations à la communauté de Corinthe, aujourd’hui inacceptables : « Que les femmes se taisent dans les assemblées : il ne leur est pas permis de parler » (cf. 1 Co 14,34-35).
« Marthe, elle, était accaparée par les multiples tâches du service. Elle intervint et dit : ‘Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur m’ait laissée seule à faire le service ? Dis-lui donc de m’aider’. »
Marthe et Marie aiment toutes deux Jésus, mais leurs priorités sont différentes. Marie fixe son attention sur Jésus et savoure sa présence. Marthe, absorbée par les tâches, cède à l’agitation, à l’impatience et à la fatigue. Et la présence de Jésus devient pour elle un fardeau.
Voilà le problème !
« Le Seigneur lui répondit : ‘Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée’. »
L’irritation de Marthe pousse Jésus à l’interpeller avec tendresse (ce que souligne la répétition de son prénom : « Marthe, Marthe ») pour la recentrer sur l’essentiel, pour l’inviter à se convertir à « l’unique nécessaire », à la recherche du Royaume de Dieu. Le reste lui sera donné en plus (cf. Luc 12,31).
La multiplicité des tâches n’est pas forcément synonyme du « service » que Jésus attend de nous. Il faut donc établir des priorités. En d’autres termes, il faut discerner. Comme le dit Paul : « Je demande que votre amour abonde encore davantage en connaissance et en pleine intelligence pour discerner ce qui est le meilleur » (Philippiens 1,9-10).
Combien de fois tombons-nous nous aussi dans le piège de l’activisme. Nous remplissons notre agenda d’une foule d’activités. Et parfois, submergés par les « urgences », nous négligeons les priorités. Notre satisfaction en fin de journée serait d’avoir « tout accompli », chose qui arrive rarement, et qui nous laisse une amère impression d’inachevé, voire de frustration.
Il faudrait au contraire apprendre à ne pas « tout faire », mais à toujours laisser quelque chose pour le lendemain, en le confiant au Seigneur qui agit pendant que nous dormons. Nous ferions alors l’expérience de la vérité de cette parole du psalmiste : « En vain vous levez-vous tôt, vous couchez tard, et mangez un pain de douleur : à son bien-aimé, Il donne le sommeil » (Ps 127,2).
P. Manuel João Pereira Correia, mccj
Quelle hospitalité ?
Luc 10,38-42
La tentation pourrait être d’opposer Marthe et Marie, comme on oppose le « spirituel » et le « temporel », « vie active » et « vie contemplative », ou encore « la parole » et « les actes ». Dans ces oppositions, le « spirituel » ou la « vie contemplative » sont valorisés aux dépens du « temporel » ou de la « vie active », même si, dans les faits, ceux-ci sont rarement délaissés… Ces clivages peuvent d’ailleurs traverser plusieurs plans de notre existence surtout lorsque nous nous sentons tiraillés entre la multitude des sollicitations auxquelles nous cherchons à répondre, au risque de nous éparpiller, et l’aspiration à une certaine unité de vie imaginée dans la relation avec le Seigneur. De sorte que ce récit ouvre moins la porte à une répartition entre « les actifs » et « les contemplatifs », qu’à une réflexion sur une ligne de tension qui traverse toute existence humaine, voire la vie de l’Église elle-même.
Au plan ecclésial, les chrétiens, y compris leurs pasteurs, peuvent se sentir partagés entre la priorité aux divers services que rend l’Église, et l’accent mis sur la méditation de l’Écriture pour que vive la Parole de Dieu. La tension est ancienne (cf. Ac, 6)… Comment ces dimensions sont-elles reliées ? De quel esprit ce le lien est-il animé ? Le récit de Marthe et Marie ouvre un chemin pour vivre cette tension dans l’hospitalité offerte au Verbe de Dieu.
Même si Jésus relève que « Marie a choisi la meilleure part », le vocabulaire ne permet pas d’en conclure qu’il aurait choisi Marie contre Marthe, la seconde ayant choisi la mauvaise part. Car les « multiples occupations du service » n’ont rien de méprisable, surtout lorsqu’il s’agit de l’hospitalité, une pratique particulièrement noble dans la culture locale. Le vocabulaire est celui de la diaconia, du service et, ici, du service de l’hospitalité. À aucun moment Marthe n’est encouragée à renoncer à l’hospitalité. Reste qu’elle pratique l’hospitalité de telle manière qu’elle éprouve une forme de solitude, voire d’isolement. Au lieu d’en ressentir paix et joie, les fruits de l’Esprit, elle éprouve un sentiment d’agitation, de désordre et en vient à récriminer.
Puisque le Seigneur ne méprise pas les occupations du service rendu par Marthe, mais son agitation, la « meilleure part » choisie par Marie est moins à chercher du côté de l’activité, que du côté de son attitude. La « seule chose » nécessaire est l’écoute de la parole de Dieu, incarnée par Jésus, médiation pour discerner la réalité de la présence de Dieu dans la vie du monde. Pratiquer l’hospitalité est une chose. Pratiquer l’hospitalité en écoutant la parole de Dieu en est une autre. Marie pratique l’hospitalité en incluant l’hospitalité accordée à la Parole de Dieu.
« N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges » affirme la Lettre aux Hébreux en référence à l’hospitalité d’Abraham et de Sarah à Mambré (Gn 18). L’écoute hospitalière de la Parole de Dieu élargit d’emblée l’hospitalité à la dimension universelle du projet de Dieu pour l’humanité : la rassembler, sans autre critère de préférence que la foi au Christ qui bouscule toute frontière, y compris confessionnelle.
Plutôt que d’opposer « spirituel » et « temporel », cet épisode fait de la gestion du temporel l’indicateur de l’Esprit qui anime les disciples de Jésus. Ces dernières années, des études pointent un durcissement des cœurs face au devoir d’hospitalité envers les migrants ou les personnes pauvres. Le pape François le sait, lui qui rencontre une forme d’incompréhension, voire de résistance parmi les chrétiens, lorsqu’il appelle les Occidentaux à « une grande responsabilité dont personne ne peut s’exonérer si nous voulons achever la mission de salut à laquelle le Seigneur lui-même nous a appelé à collaborer. » Une responsabilité qui nous renvoie à notre pratique de l’hospitalité.
François Picart, prêtre de l’Oratoire
https://croire.la-croix.com