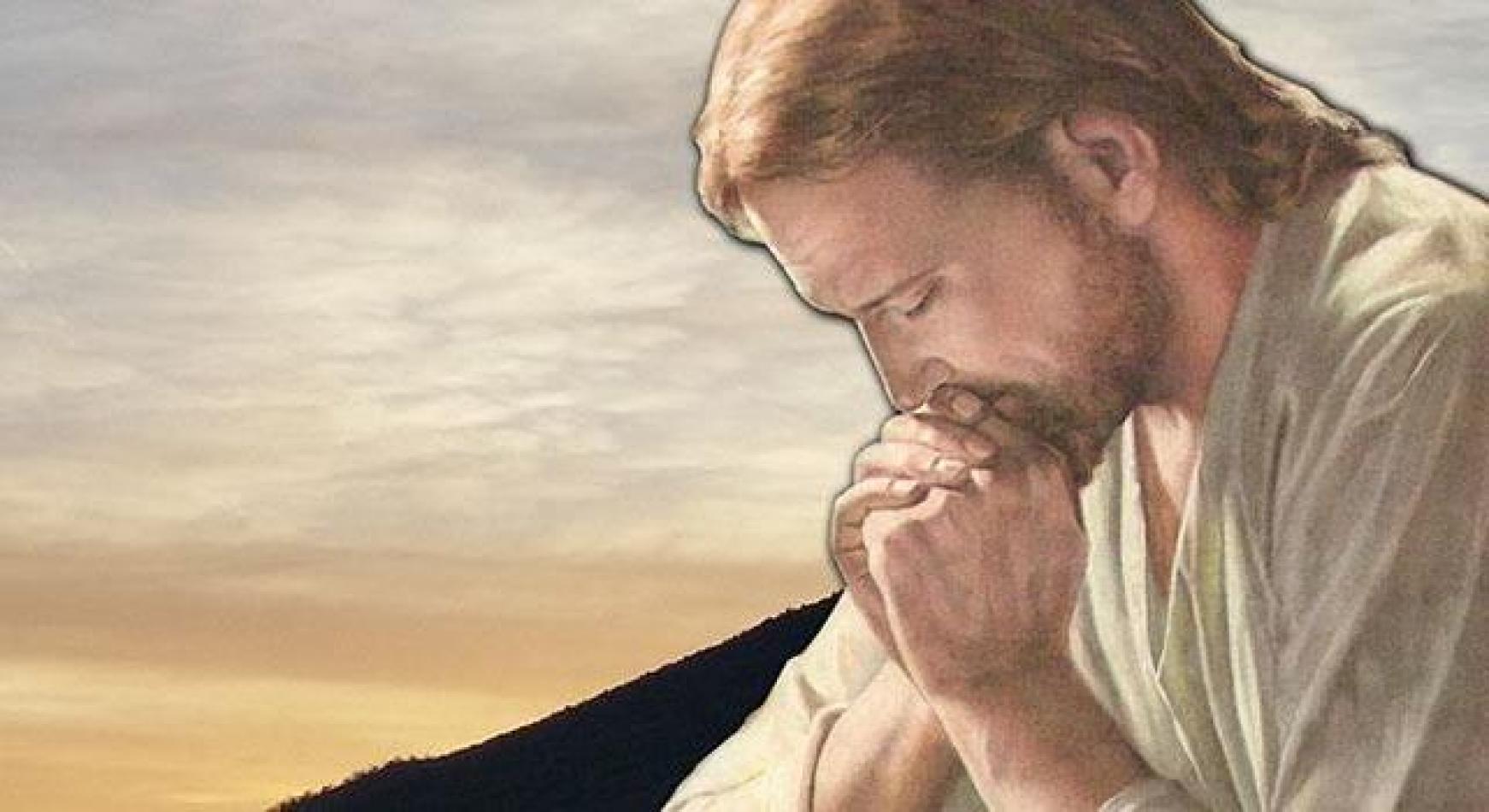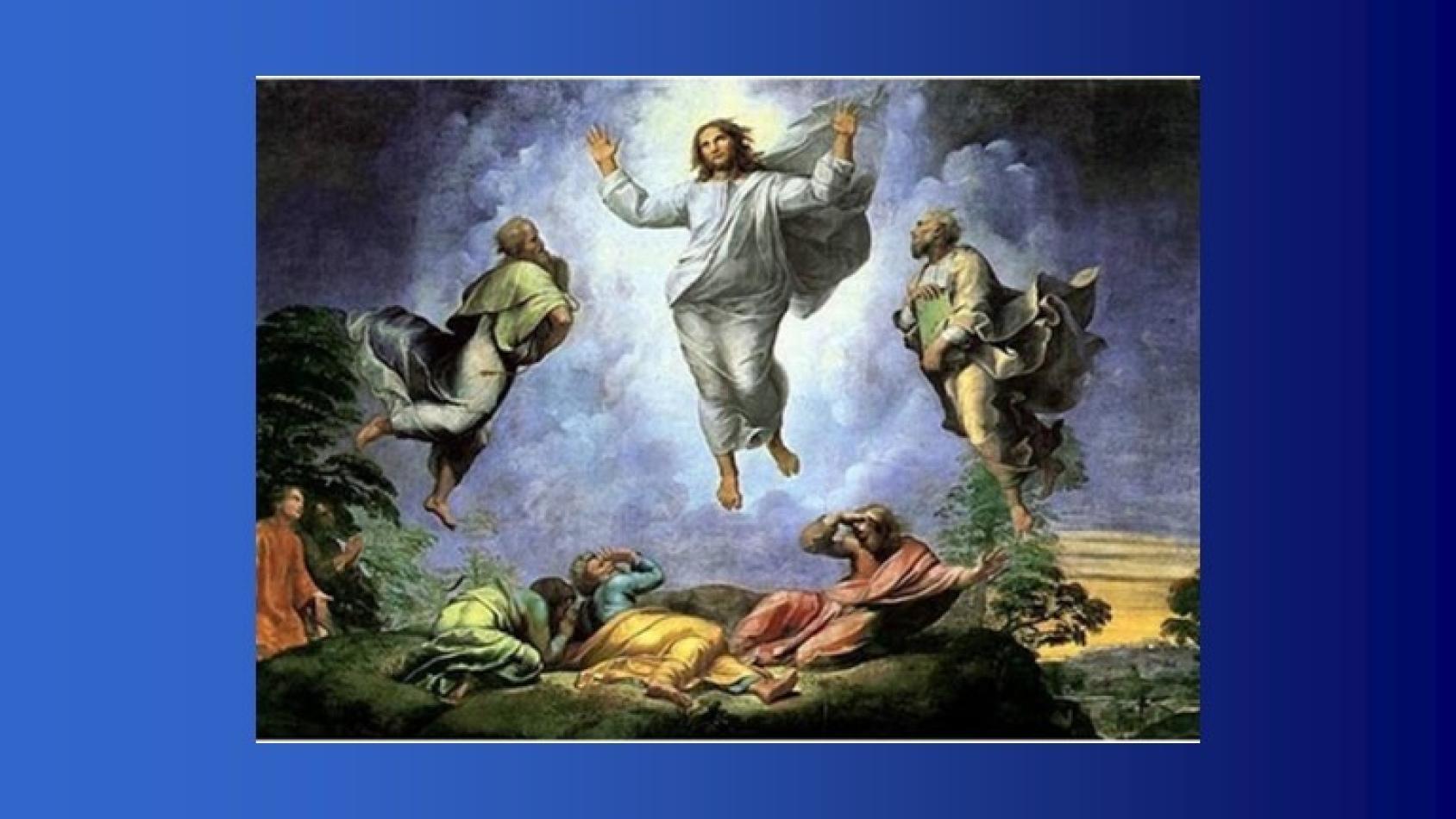Daniel Comboni
Missionnaires Comboniens
Zone institutionnelle
D’autres liens
Newsletter
L'Évangile de ce dimanche nous offre la version lucanienne du Notre Père. Nous connaissons par cœur celle de l'Évangile selon saint Matthieu, articulée en sept demandes (Mt 6,9–13). Celle de saint Luc, plus courte, n’en contient que cinq. Cette différence n’en altère cependant pas la substance. [...]
« Seigneur, apprends-nous à prier. »
Luc 11,1–13
L'Évangile de ce dimanche nous offre la version lucanienne du Notre Père. Nous connaissons par cœur celle de l'Évangile selon saint Matthieu, articulée en sept demandes (Mt 6,9–13). Celle de saint Luc, plus courte, n’en contient que cinq. Cette différence n’en altère cependant pas la substance.
« Jésus était en prière en un certain lieu ; quand il eut terminé, un de ses disciples lui dit : Seigneur, apprends-nous à prier. » Ce disciple anonyme représente chacun de nous. Contempler Jésus plongé dans la prière suscite en nous le désir d’entrer dans son expérience d’intimité profonde avec le Père, nous qui avons tant de mal à prier.
Le passage de l’Évangile se compose de trois parties :
– la prière de Jésus et l’enseignement du Notre Père (vv. 1–4) ;
– la parabole de l’ami importun (vv. 5–8), pour nous inviter à prier sans nous décourager ;
– enfin, la comparaison avec la relation père-fils (vv. 9–13), pour réveiller en nous la confiance d’un enfant :
« Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »
Dieu : Père ou parâtre ?
Jésus parle à partir de son expérience de Fils. Mais pourquoi la nôtre est-elle parfois si différente ? Il arrive – inconsciemment – que nous pensions que le Père céleste soit plus sévère que notre père terrestre. Voltaire écrivait : « Personne ne voudrait avoir Dieu comme père terrestre », et F. Engels concluait : « Quand un homme connaît un Dieu plus dur et méchant que son père, alors il devient athée » (citations tirées d'Enzo Bianchi).
D’où vient cette image tragiquement faussée de Dieu ? Peut-être de nos déceptions dans la prière ? Et celles-ci ne seraient-elles pas dues à une fausse idée de la prière ? En réalité, beaucoup de nos prières sont des demandes de… « miracles » ! Il est possible de demander des miracles, mais cela comporte un risque ! L’Écriture considère que cela peut être une manière de « tenter Dieu » (cf. Lc 4,12), car cela revient à réduire Dieu à un idole — et les idoles déçoivent toujours !
La prière, au contraire, est l’expression suprême de la foi, de l’espérance et de la charité. Et lorsque la prière est faite avec confiance, espérance et amour filial, alors oui, le miracle se produit — non pas tant à l’extérieur, mais en nous-mêmes — grâce à l’action transformante de l’Esprit Saint.
Quelques pistes de réflexion sur le Notre Père
Père, que ton nom soit sanctifié, que ton Règne vienne
« Père » est un nom donné à Dieu dans de nombreuses religions. L’originalité chrétienne réside dans la conscience d’être « fils dans le Fils ». La nature de cette prière — exprimée à la première personne du pluriel — est éminemment missionnaire, car le « nous » englobe non seulement la communauté chrétienne, mais toute l’humanité.
Nous demandons d’abord au Père la sanctification de son Nom. Mais en nous, en premier lieu : « Vous ne profanerez pas mon saint nom » (Lv 22,32). Chacun de nous peut être le lieu d’une sanctification continue du Nom de Dieu, en révélant sa Paternité — ou, au contraire, de sa profanation.
La deuxième demande est la venue du Règne de Dieu. C’était un besoin profondément ressenti au temps de Jésus. Dans le Nouveau Testament, l’expression « Royaume de Dieu » apparaît 122 fois, dont 90 dans la bouche de Jésus (F. Armellini). Royaume et Évangile semblent se confondre dans la prédication de Jésus (cf. Mc 1,15). Les fils du Royaume sont le ferment des « cieux nouveaux et d’une terre nouvelle où la justice habitera » (2 P 3,13).
Donne-nous chaque jour notre pain quotidien
La demande la plus humble se trouve au centre de la prière du Notre Père : elle est la troisième des cinq chez Luc, la quatrième des sept chez Matthieu. Peut-être pas par hasard. C’est dans le partage du pain que se révèle notre sentiment de filiation et de fraternité.
Au temps de Jésus, le pain avait une forte valeur symbolique : il était considéré comme sacré. Le rompre et le partager, après la bénédiction du chef de famille, représentait le geste suprême de la communion familiale. On rompait le pain à la main, avec délicatesse, jamais avec un couteau.
Demander à Dieu le pain quotidien signifie reconnaître que tout vient de sa paternité, et implique un profond sens de fraternité : celui qui prie le Notre Père le fait au pluriel, demandant le pain pour tous, pas seulement pour lui-même. En outre, cette demande comporte un appel fort à la sobriété, en référence à l’expérience de la manne dans le désert : elle devait être recueillie chaque jour, sans en accumuler pour le lendemain (Ex 16,19–21). L’accumulation menait à la pourriture.
Nous vivons dans un monde où les inégalités sociales sont devenues une réalité dramatique et intolérable. Il y a quelques jours, une étude de l’ONG Oxfam révélait que quatre milliardaires africains possèdent plus de la moitié des richesses du continent. Aujourd’hui, nous aurions besoin de voix prophétiques comme celle de saint Jean Chrysostome — et de bien d’autres Pères de l’Église — capables de crier comme lui : « Le riche est un voleur ou l’héritier de voleurs ! » C’est pourquoi la demande du « pain quotidien » est la plus révolutionnaire et la plus dérangeante du Notre Père.
… et pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes pardonnons à tous ceux qui nous doivent quelque chose, et ne nous laisse pas entrer en tentation
La demande de pardon est la manière la plus authentique de se placer devant Dieu. Nous demandons pardon pour « nos péchés » : les miens, les nôtres, et ceux de toute l’humanité. Cette demande suppose en nous un vif sens du péché — ce qui est loin d’être évident — et un constant et sincère dialogue avec la Parole de Dieu. Nous sommes souvent, nous aussi, comme les pharisiens : experts à « filtrer le moucheron et avaler le chameau » (Mt 23,24), prompts à confesser nos « petits péchés » tout en fermant les yeux sur les graves injustices dont nous sommes, à divers degrés, complices.
À la demande de pardon s’ajoute celle concernant la tentation. Mais quelle tentation ? Le mot grec peut aussi signifier « épreuve ». L’épreuve fait partie intégrante du chemin de foi : elle peut purifier, mais aussi mettre en péril. C’est pourquoi nous demandons au Père de nous soutenir. Il existe des épreuves exceptionnelles, mais aussi des épreuves quotidiennes, plus sournoises. Parfois, il suffit de la monotonie de la vie, de l’usure du quotidien ou simplement du temps qui passe pour éteindre l’enthousiasme et refroidir la foi.
Dans le Notre Père, on parle de « tentation » ou « d’épreuve » au singulier, et pour en comprendre le sens, on peut regarder l’expérience de Jésus. Il affronte deux moments d’épreuve : dans le désert, où il doit choisir entre suivre la Parole de Dieu ou céder à la logique du monde, et dans la Passion, en particulier au jardin de Gethsémani, où il se confronte à un visage de Dieu bouleversant et mystérieux, représenté par la croix. Ces deux épreuves, bien que distinctes, sont profondément liées : toutes deux mettent à l’épreuve la fidélité à la mission selon la logique du Royaume de Dieu. Ainsi, l’épreuve — ou la tentation — dont il est question dans le Notre Père n’est pas simplement celle de l’homme aux prises avec les difficultés de la vie. C’est celle du disciple, du missionnaire, qui a fait du Royaume son désir principal, la seule raison de sa vie. (Bruno Maggioni)
Pour la réflexion personnelle
Méditer et intérioriser cette affirmation surprenante et extraordinaire de Jésus :
« Eh bien moi, je vous dis : demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et à qui frappe, on ouvrira. »
P. Manuel João Pereira Correia, mccj
Références bibliques :
Lecture du livre de la Genèse. 18. 20 à 32 : Pour dix, je ne détruirai pas Sodome. »
Psaume 137 : » Seigneur, éternel est ton amour. N’arrête pas l’oeuvre de tes mains. »
Lecture de la lettre de saint Paul aux Colossiens : 2. 12 à 14 : « Avec Lui, vous avez été ressuscités parce que vous avez cru en la force
e Dieu. »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc : 11. 1 à13 : « Combien plus le Père céleste donnera-t-il l’Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent. »
La première lecture de ce dimanche est choisie, comme souvent, pour préparer à entendre dans l’Evangile la Parole du Seigneur. Aujourd’hui : »Demandez et vous obtiendrez; cherchez et vous trouverez; frappez et la porte vous sera ouverte. »
Abraham nous est présenté, dans cette liturgie, comme un exemple d’intercesseur, même si sa manière d’agir est discutable. Elle l’est parce que sa connaissance de Dieu est imparfaite. Nous ne sommes qu’au seuil de la révélation.
LES PROTAGONISTES
Il est encore avec ses trois visiteurs que nous connaissons par la première lecture de dimanche dernier (Genèse 18. 1 à 10). Ce sont trois hommes ou trois anges (l’ange biblique étant défini par la mission reçue de Dieu, comme cela nous est dit par leur nom personnel).
Passant à côté du campement d’Abraham, ils ont été invités par lui selon le devoir de l’hospitalité. Ils ont réitérés à Abraham et à Sara la promesse d’une descendance.
Ils sont au nombre de trois, mais il n’empêche que, dans la scène lue dimanche dernier, ils parlent ou Abraham s’adresse à eux comme s’ils n’étaient qu’un seul : comme anges du Seigneur, ils sont à la fois multiples et un.
Nous sommes aujourd’hui dans la continuité de cet événement au moment où deux d’entre eux se décident à partir pour Sodome tandis qu’Abraham reste en présence du troisième. Cette unité et cette « trinité » est une particularité de ce texte dont les exégètes ne peuvent nous donner des explications rationnelles; par exemple, il y aurait là l’imbrication de plusieurs rédactions différentes. Quoi qu’il en soit, celui qui a composé le texte en son état actuel a accepté d’apparentes contradictions au nom de sa conception du « messager » de Dieu.
La discussion entre lui et Abraham concerne les habitants de Sodome, dont Lot son neveu et sa famille. « Or les gens de Sodome étaient de grands scélérats et pécheurs contre le Seigneur. » (Genèse 13. 13) Leur violence « crie » vers Dieu et Dieu regarde le coeur des hommes, à la différence de ceux-ci qui voient surtout l’apparence. C’est, pour chacun d’entre nous, source de confiance, car le Seigneur est tendresse et miséricorde.
DIEU EST-IL EN ACCUSATION ?
Abraham, dans cette discussion, se met, dans la position du juste et Dieu est mis au banc des accusés : « Celui qui juge toute la terre va-t-il rendre une sentence contraire à la justice ? » (Gen. 18. 25). Dieu doit se défendre d’une attitude qu’Abraham juge injuste.
Nous sommes dans un récit « vivant » où Dieu est proche des hommes, même dans sa manière familière d’agir et de réagir. Son regard n’est pas omniscience impassible. Dieu « descend pour voir ». Ce qui arrive sur terre importe à Dieu et il vient se rendre compte par lui-même. L’homme peut juger sur des on-dit, voire des accusations qu’il sait mensongères, Dieu ne peut agir ainsi, il se doit de connaître pour juger avec équité.
Et c’est bien là que réside l’imperfection d’Abraham. Comme si Dieu pouvait se laisser aller à cette injustice que constitue le meurtre d’un innocent, une injustice plus grave que l’amnistie du coupable.
ET POURTANT SODOME SERA DETRUITE
Le manque de foi d’Abraham se caractérise par le fait qu’il s’arrête à dix justes. Comme si Dieu pouvait se résoudre à condamner neuf innocents, neuf justes parmi les habitants de Sodome…. La Bible répondra plus tard par la bouche des prophètes : non, Dieu n’agit pas ainsi. « Parcourez les rues de Jérusalem, proclamait le prophète Jérémie. Cherchez sur ses places si vous découvrez un homme, un qui pratique le droit, qui recherche la vérité. Alors je pardonnerai à cette ville, dit le Seigneur. » (Jérémie 5. 1)
Or il y avait bien un juste à Sodome : c’était Lot. Mais sa présence n’empêchera pas la condamnation de la ville. Même si Dieu le sauve personnellement, lui et toute sa famille qui fait corps avec lui, ce juste ne peut sauver la ville dont il n’est pas citoyen. Il n’est qu’un étranger.
On voit ainsi le chemin parcouru entre ce moment de la révélation à Abraham et le Nouveau Testament où Dieu ne vient pas seulement pour « voir », mais pour sauver.
Ce salut se réalise dans le Christ, homme parmi les hommes de la cité pécheresse, en tout semblable à eux hormis le péché. Il est le seul juste parmi la totalité des pécheurs. « Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné tous nos péchés…. en le clouant sur le bois de la croix. » (Colossiens 2. 14) Désormais Dieu trouve parmi nous un répondant, le salut est possible car le Christ n’est pas un étranger. Il est l’un de nous. Un seul est devenu cause de salut pour tous.
Abraham ne pouvait imaginer une telle réalité. Il ignorait encore ce « combien plus » dont nous parle le Christ dans l’Evangile . (Luc 11. 13).
***
La prière d’action de grâce du psaume prend alors une toute autre résonance : »De tout mon coeur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche… tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole. » « Que ton nom soit sanctifié ! »
« Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi rien n’est fort et rien n’est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. » (Prière du début de la liturgie de la parole.)