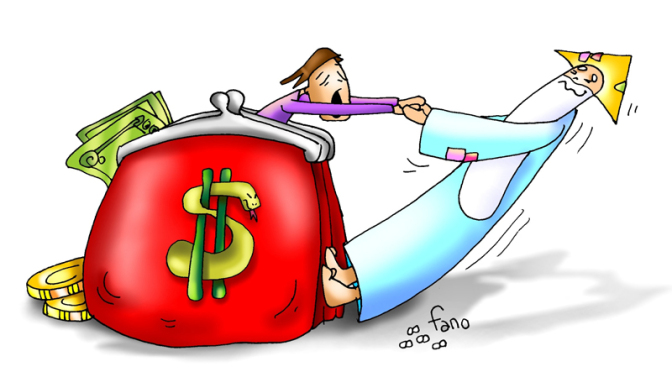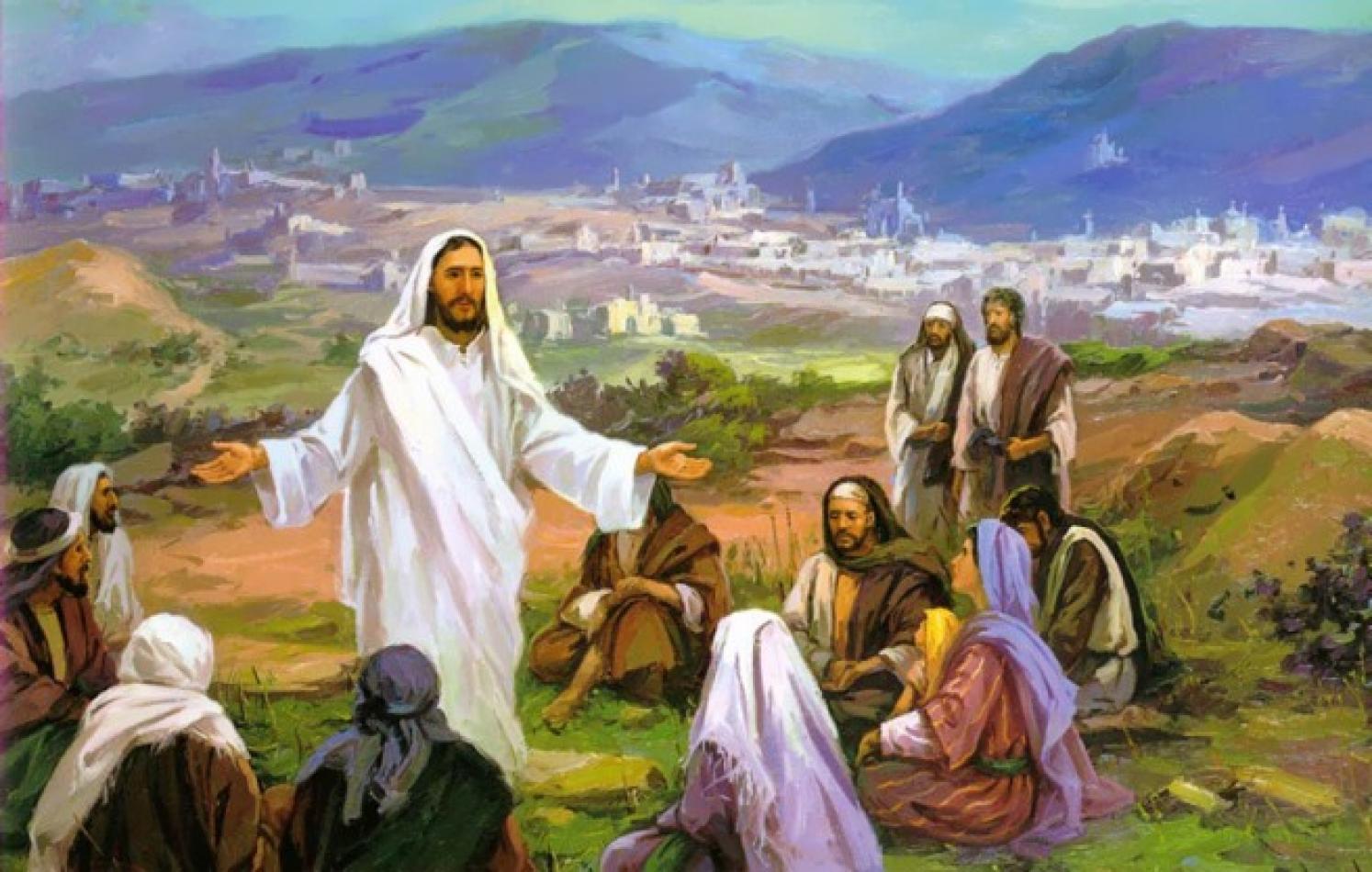Daniel Comboni
Missionnaires Comboniens
Zone institutionnelle
D’autres liens
Newsletter
Les lectures de ce dimanche peuvent sembler difficiles à comprendre. Dans la première lecture, Amos, le prophète berger et cultivateur du VIIIᵉ siècle, prend la défense de l’indigent et menace de la vengeance de Dieu ceux qui « écrasent le pauvre » (Am 8,4-7). Un avertissement plus que jamais actuel. Mais, dans l’Évangile, Jésus raconte une parabole où il semble louer un administrateur malhonnête. C’est l’une des paraboles les plus discutées de l’Évangile. En réalité, ce que l’on veut mettre en valeur, c’est la promptitude et l’habileté de cet administrateur. Ce sont ces qualités que Jésus propose aux « fils de la lumière ». Voilà pourquoi cette parabole est aussi appelée celle de « l’administrateur avisé ». [...]
Administrateurs résolus et habiles
« Faites-vous des amis avec la richesse injuste. »
Luc 16,1-13
Les lectures de ce dimanche peuvent sembler difficiles à comprendre. Dans la première lecture, Amos, le prophète berger et cultivateur du VIIIᵉ siècle, prend la défense de l’indigent et menace de la vengeance de Dieu ceux qui « écrasent le pauvre » (Am 8,4-7). Un avertissement plus que jamais actuel. Mais, dans l’Évangile, Jésus raconte une parabole où il semble louer un administrateur malhonnête. C’est l’une des paraboles les plus discutées de l’Évangile. En réalité, ce que l’on veut mettre en valeur, c’est la promptitude et l’habileté de cet administrateur. Ce sont ces qualités que Jésus propose aux « fils de la lumière ». Voilà pourquoi cette parabole est aussi appelée celle de « l’administrateur avisé ».
Administrateurs, pas propriétaires !
Laissons de côté les aspects exégétiques les plus problématiques pour nous concentrer sur le message principal. Le mot-clé est administrateur. Les termes administrateur / administration / administrer (en grec oikonomos, oikonomia, oikonomeō) apparaissent 7 fois dans notre texte. Il ne s’agit pas d’une terminologie courante dans le NT. Cependant, même si elle apparaît peu, l’idée d’« être administrateur » (oikonomos) de ce que Dieu nous a confié est un thème récurrent et fondamental dans la théologie néotestamentaire.
Saint Paul nous dit : « Que l’on nous considère comme des serviteurs du Christ et des administrateurs des mystères de Dieu » (1 Co 4,1) ; et saint Pierre : « Que chacun, selon le don qu’il a reçu, le mette au service des autres, comme de bons administrateurs de la grâce multiforme de Dieu » (1 P 4,10). Ne pensons pas seulement aux grâces spirituelles, mais aussi aux dons naturels et aux biens matériels.
Voici donc le premier point de notre réflexion : nous sommes de simples administrateurs, pas des propriétaires. Autrement dit, nous devons nous occuper des choses, des biens, de l’argent, comme des gestionnaires. Même les biens sont des talents confiés à nous. Ils ne nous appartiennent pas et nous ne pouvons pas les retenir. Il faut les faire circuler et fructifier avec résolution et intelligence ! Non pour notre profit personnel, mais au service des autres et du Royaume.
Aujourd’hui, il n’existe plus de valeur aussi universelle que l’argent. Nous passons la majeure partie de notre temps à gagner notre vie. Mais même l’argent gagné à la sueur de notre front ne nous appartient pas, pour l’utiliser comme bon nous semble. D’ailleurs, nous savons que le système monétaire actuel est injuste et inéquitable. Nous ne pouvons pas nous auto-absoudre en disant que nous n’y pouvons rien. Il faut l’administrer avec sagesse et en tenant compte de ce que dit Paul VI dans Populorum Progressio : « La propriété privée ne constitue pour personne un droit inconditionnel et absolu. Personne n’est autorisé à réserver à son usage exclusif ce qui dépasse son besoin, alors que d’autres manquent du nécessaire » (n. 23).
Les pauvres, portiers du Paradis !
La Parole de ce dimanche nous parle aussi de l’amitié. Des relations humaines corrompues par l’avidité et l’injustice, dénoncées par le prophète Amos. Des relations de fraternité avec tous les hommes, qui garantissent la paix et la justice, comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture : « afin que nous puissions mener une vie calme et paisible, digne et consacrée à Dieu » (1 Tm 2,1-8). Mais c’est surtout Jésus, dans l’Évangile d’aujourd’hui, qui fait une proposition inattendue : « Faites-vous des amis avec la richesse injuste, afin que, lorsqu’elle viendra à manquer, ils vous accueillent dans les demeures éternelles ».
Alors, les pauvres seraient-ils les portiers du Paradis ? Apparemment, oui. Selon Mt 25,11-12, Jésus sera le Juge qui décidera qui pourra entrer dans le Royaume des Cieux : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! ». Mais il répondit : « En vérité je vous le dis : je ne vous connais pas ». Et de même en Mt 7,22-23 : « Ce jour-là, beaucoup me diront : “Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en ton nom ? En ton nom n’avons-nous pas chassé les démons ? En ton nom n’avons-nous pas accompli beaucoup de prodiges ?” Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité !” ».
Ici, en Lc 16,9, cela sonne un peu différemment. Voici comment un catéchiste du Mozambique l’expliquait à ses catéchumènes, selon le récit d’un collègue missionnaire :
Quand nous arriverons aux portes du Paradis et que nous frapperons pour pouvoir entrer – oui, car le Paradis a des portes, tout le monde n’y entre pas ! – saint Pierre apparaîtra, à qui Jésus a confié les clés du Royaume des Cieux, et demandera : – « Qui es-tu ? » – « Je suis untel ». Mais comment Pierre pourrait-il connaître tout le monde ?! Très simple : Pierre criera à l’intérieur et demandera : – « Hé, les amis, il y a un tel qui demande à entrer ; quelqu’un le connaît ? ». Alors quelqu’un répondra (du moins on l’espère !) : – « Oui, je le connais, il m’a souvent donné à manger ». Et un autre : – « Je le connais aussi, il est venu me visiter plusieurs fois quand j’étais malade ». Et un autre encore : – « Il m’a donné des vêtements pour me couvrir ». Alors Pierre ouvrira la porte : – « Entre, ami, tu es des nôtres ! ».
Mais si, de l’intérieur, ils secouent la tête en disant qu’ils ne le connaissent pas, alors oui, ce sera de graves ennuis !
Il semble donc que les pauvres soient le jury de saint Pierre. Voilà pourquoi Jésus recommande : « Faites-vous des amis avec la richesse injuste, afin que, lorsqu’elle viendra à manquer, ils vous accueillent dans les demeures éternelles ». C’est pourquoi il n’hésite pas à nous donner « l’administrateur malhonnête » comme exemple d’habileté !
On dirait presque que, pour entrer au Paradis, il faut des recommandations ! Mais non pas à saint Pierre, mais aux pauvres, et ici sur la terre, avant qu’il ne soit trop tard !
Manuel João Pereira Correia, mccj
Le choix de Dieu
Luc 16,1-13
Pourquoi l’argent est-il qualifié de malhonnête ? Pour celui des exploiteurs. Pour la réussite d’une vie, les paroles de Jésus posent le problème essentiel, celui de la construction d’une unité intérieure chez un être humain, chez tout être inévitablement affronté à ses divisions. En arrière-fond, le double commandement de l’amour : la relation à Dieu passe par la relation à l’autre dans l’altérité, c’est-à-dire dans la reconnaissance de sa différence.
La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Chaque individu est engagé dans une terrible bataille avec ses pulsions qui le divisent en l’entraînant dans mille et une directions. Il doit y mettre des limites, renoncer à certaines ou les déplacer (la sublimation), s’il veut se construire en tant que sujet, auteur de sa vie, et devenir lui-même, exister par lui-même, autrement dit devenir « quelqu’un ». Mais lui arrive-t-il un jour de n’être plus soumis comme un esclave à ses pulsions qui l’empêche d’entrer dans une vraie relation à l’autre, son prochain ?
Il y a bien sûr une première étape dans la vie, l’enfance, qui permet par le biais de l’éducation des parents dans le cadre d’une culture d’intégrer des valeurs, des interdits, et de bâtir des « digues » face aux premières pulsions anarchiques et perverses. L’enfant n’est pas un ange ! Mais il y a ensuite la seconde étape, l’âge adulte, pendant laquelle c’est l’individu lui-même qui doit s’imposer des limites et poursuivre sa construction, son individualité, comme un artiste accomplit une œuvre. Dans cette bataille se joue le développement (psychique) de sa personne ou, malheureusement sa destruction. Elle suppose qu’il fasse en permanence des choix impliquant sa liberté. Une bataille avec lui-même et ses propres démons le rendant si fragile, mais constituant le chemin même de sa liberté pour devenir lui-même.
Jésus s’exprimait dans un contexte social et culturel où, selon le droit de succession ou le droit de propriété, il était possible d’appartenir à deux maîtres. Les rabbins, de leur côté, développaient l’idée que l’individu avait deux maîtres, l’un humain, l’autre divin. Dans ce contexte, la parole de Jésus est d’autant plus étonnante et surtout tranchante : un individu doit choisir, il ne peut avoir qu’un seul et même maître !
Jésus pointe très justement l’emprise de l’argent. Très vite, les premiers commentaires des Pères de l’Église comme Ambroise, l’évêque de Milan, associeront la sexualité à l’argent, l’argent fonctionnant d’ailleurs souvent comme substitut de la sexualité comme moyen d’assouvir une pulsion. Dans le raisonnement du Nazaréen, l’emprise de l’argent, lorsque celle-ci devient l’axe principal d’une vie, s’oppose à une relation « vraie » à l’autre. L’argent étant alors un outil pour dominer l’autre, dans le fantasme de toute-puissance, dans une volonté d’imposer sa loi à l’autre. Cet « autre » n’existe alors plus ; il est réduit à n’être qu’un objet de satisfaction.
Pour Jésus, le seul chemin pour trouver le bonheur de vivre dans une relation vraie à l’autre, c’est de choisir l’amour non de soi, mais de l’autre. Pas de soumission à cet autre, mais une mise à son « service » pour qu’il trouve son propre bonheur. C’est le choix qui unifie la personne.
Enfin, pour Jésus, c’est dans le choix d’une relation positive à l’autre que s’inscrit la relation à Dieu. L’une et l’autre ne font qu’une. Le « maître » n’est plus alors la pulsion qui, seule, est destructrice, mais le désir se transformant en un véritable amour passant par le don de sa vie à l’autre. L’acte du don est celui de la vraie liberté. Elle suppose l’accord de tout l’être qui entre dans la dynamique de la création.
L’intervention de Jésus ne se limite donc pas à l’énonciation d’une morale. Elle est un appel « à la vie », dans une unité intérieure tournée vers l’autre, qui ne peut se réaliser que dans un acte de foi en un Dieu « Père ». La coupure avec l’être pulsionnel tourné uniquement sur lui-même passe par un saut vers l’autre qui est déjà un acte d’amour, mais qui suppose une connaissance de Dieu, une rencontre qui lui révèle son amour infini et rend crédible Sa promesse, dans une confiance absolue. Seul l’amour de Dieu permet la transformation d’un être et sa « réalisation » (Soren Kierkegaard), le faisant passer de la servitude à la liberté d’aimer.
Daniel Duigou
ARGENT
La société contemporaine de Jesús était très différente de la nôtre. Seules les familles puissantes de Jérusalem et les grands propriétaires terriens de Tibériade pouvaient accumuler des pièces d’or et d’argent. Les paysans, eux, pouvaient à peine acquérir quelques pièces de monnaie, soit en bronze ou en cuivre et de peu de valeur. Ils étaient nombreux ceux qui vivaient sans argent, échangeant des produits dans un régime de pure subsistance.
C’est dans cette société-là que Jésus parle de l’argent avec une fréquence surprenante. Sans terres ni travail fixe, sa vie itinérante de prophète consacré à la cause de Dieu, lui permet d’en parler avec une liberté totale. D’autre part, son amour pour les pauvres et sa passion pour la justice de Dieu, le poussent à toujours défendre les laissés-pour-compte.
Il parle sur l’argent avec un langage très personnel. Il l’appelle spontanément «argent injuste» ou «richesses injustes». Il ne connaît pas, vraisemblablement, «de l’argent propre». La richesse de ces gens puissants est injuste parce qu’elle a été accumulée de manière injuste et parce qu’ils en jouissent sans la partager avec les pauvres et les affamés.
Que peuvent-ils faire ceux qui possèdent ces richesses injustes? Luc a conservé quelques paroles curieuses venant de Jésus. Même si la phrase peut paraître un peu obscure par sa concision, son contenu ne doit pas être oublié. «Je vous dis: faites-vous des amis avec l’argent injuste pour que le jour où il vous manquera, ils vous reçoivent dans les demeures éternelles».
Voici ce que Jesús veut dire aux riches: «Utilisez votre richesse injuste pour aider les pauvres; gagnez leur amitié en partageant vos biens avec eux. Ils deviendront vos amis et, lorsque, au moment de la mort, l’argent ne vous servira plus à rien, ils vous accueilleront dans la maison du Père». Autrement dit: la meilleure façon de «blanchir» l’argent injuste devant Dieu, c’est de le partager avec ses fils les plus pauvres.
Ses paroles ne furent pas bien accueillies. Luc nous dit que «certains pharisiens qui aimaient les richesses étaient en train de l’entendre parler de ces choses-là et ils se moquaient de lui». Ils ne comprennent pas le message de Jésus. Ils ne sont pas intéressés à l’entendre parler d’argent. La seule chose qui les préoccupe c’est de connaître et d’accomplir fidèlement la loi. Ils considèrent la richesse comme un signe indiquant que Dieu bénit leur vie.
Même si elle a été renforcée par une longue tradition biblique, cette vision de la richesse comme signe de bénédiction, n’est pas évangélique. Il faut le dire à haute voix car il y a des personnes riches qui pensent, d’une manière presque spontanée, que leur succès économique et leur prospérité sont le signe, le meilleur, de l’approbation de leur vie par Dieu.
Un disciple de Jésus ne peut faire n’importe quoi avec l’argent: il existe une façon de gagner de l’argent, de le dépenser et d’en jouir, qui est injuste, car elle oublie les plus pauvres.
José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna