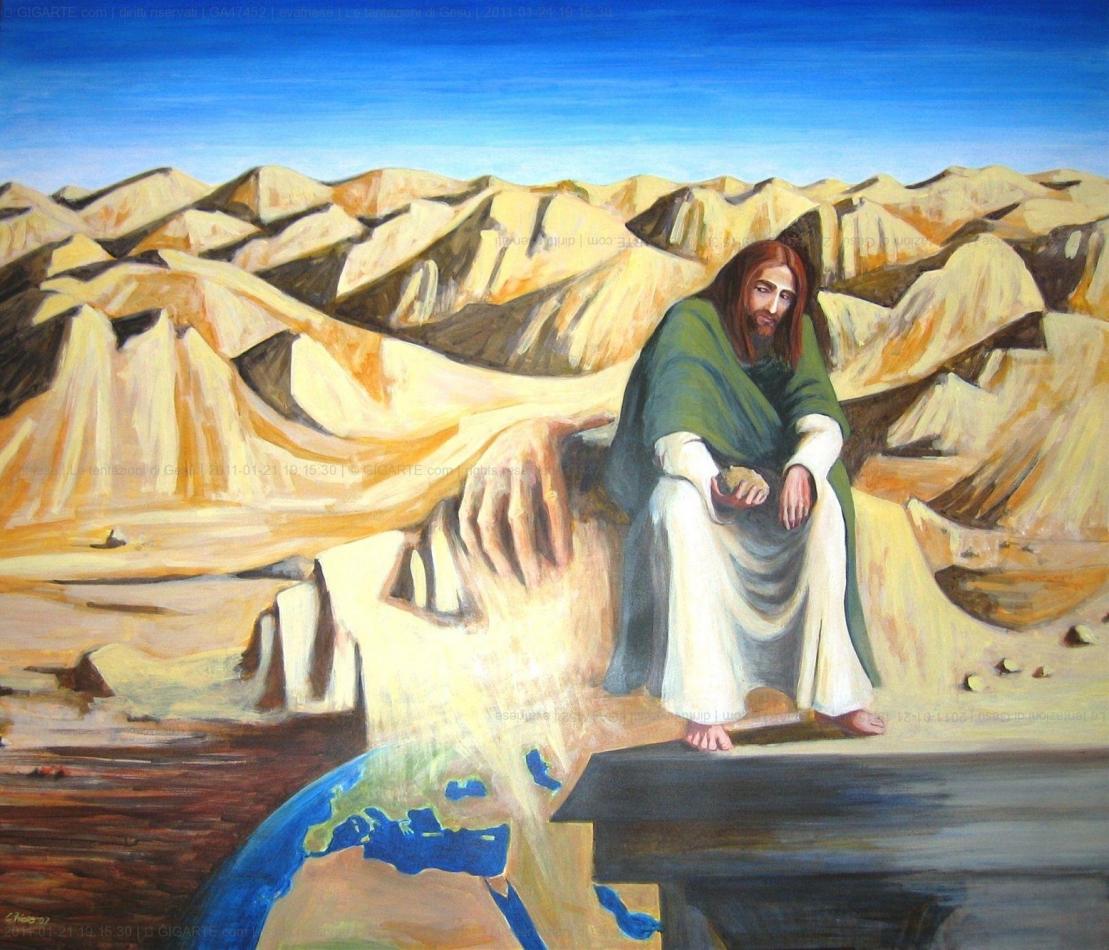Daniel Comboni
Missionnaires Comboniens
Zone institutionnelle
D’autres liens
Newsletter
En ce 30ᵉ dimanche, Jésus poursuit son enseignement sur la prière. Dimanche dernier, avec la parabole du juge corrompu et de la pauvre veuve, il nous avait dit QUAND prier : toujours, sans jamais se lasser. Aujourd’hui, il nous enseigne COMMENT prier. Et il le fait par une autre parabole, bien connue de nous : celle du pharisien et du publicain. [...]
« Quiconque s’élève sera abaissé ; celui qui s’abaisse sera élevé. »
Luc 18,9-14
En ce 30ᵉ dimanche, Jésus poursuit son enseignement sur la prière. Dimanche dernier, avec la parabole du juge corrompu et de la pauvre veuve, il nous avait dit QUAND prier : toujours, sans jamais se lasser. Aujourd’hui, il nous enseigne COMMENT prier. Et il le fait par une autre parabole, bien connue de nous : celle du pharisien et du publicain. Curieusement, la figure du juge réapparaît encore en arrière-plan des lectures de ce dimanche. Peut-être parce que nous avons du mal à nous détacher de notre image d’un Dieu Juge, qui nous justifie quand nous faisons le bien, ou nous condamne quand nous faisons le mal ?
Le pharisien et le publicain
L’évangéliste introduit le passage de l’Évangile en précisant l’intention de Jésus : cette parabole était « pour certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres ».
« Deux hommes montèrent au Temple pour prier : l’un était pharisien et l’autre publicain… »
En les présentant ainsi, Jésus a déjà bien décrit les deux personnages.
Le pharisien appartenait à un groupe religieux laïc (actif du IIᵉ siècle av. J.-C. au Iᵉʳ siècle apr. J.-C.). Étymologiquement, pharisien signifie « séparé ». Soucieux d’observer intégralement la Loi de Moïse, les pharisiens se tenaient à part pour ne pas se souiller. Ils étaient les « purs », très respectés pour leur piété et leur connaissance de la Loi.
Le publicain, lui, était un percepteur d’impôts (du latin publicanus, dérivé de publicum, « trésor public »). Les publicains étaient considérés comme pécheurs et impurs. On les méprisait et on les haïssait, car ils collaboraient avec les envahisseurs romains et exploitaient les pauvres.
Tous deux « montent » au Temple pour prier et exposent devant Dieu ce qu’ils sont vraiment — car à Dieu, on ne peut pas mentir. Le pharisien fait une prière d’action de grâce. Devant le miroir de la Loi, il se voit juste, irréprochable, et se complaît en lui-même. Il n’est pas comme les autres : il regarde autour de lui et ne voit que voleurs, injustes et adultères. Il bombe le torse et dresse le bilan de ses bonnes actions devant Dieu, son comptable. Il se sent en règle, mieux encore : il a accumulé des crédits pour le paradis. Aujourd’hui, on dirait qu’il est le chrétien parfait, irréprochable, au ciel garanti.
Le publicain, quant à lui, reste au fond. Il n’ose pas s’approcher du Saint. Le poids de ses péchés courbe sa tête. Il sait qu’il est un pécheur endurci. Il ne peut que dire : « Mon Dieu, prends pitié de moi, pécheur », en se frappant la poitrine.
Jésus conclut la parabole avec autorité : « Je vous le dis : celui-ci [le publicain qui implorait la miséricorde], et non l’autre [le pharisien qui se croyait parfait], redescendit chez lui justifié, car quiconque s’élève sera abaissé ; celui qui s’abaisse sera élevé. »
Lequel des deux me représente ?
Je l’avoue : j’aimerais être comme le pharisien
Aujourd’hui, tout le monde regarde le pharisien d’un mauvais œil et se frappe la poitrine comme le publicain. J’ai de la peine pour ce pauvre pharisien. Je l’avoue : j’envie ce pharisien ! J’aimerais être comme lui : un fidèle observant de toute la Loi ! Parfait, irréprochable ! J’ai passé ma vie à essayer de lui ressembler — sans y parvenir ! Au fond, moi aussi, j’aimerais pouvoir me réjouir, comme lui, de ma propre vie.
Il me semble que Jésus a été un peu sévère envers le pharisien, le présentant sous un mauvais jour. Et pourtant, sa prière avait bien commencé, par un remerciement. Oui, ensuite il s’est distrait, il a regardé en arrière (cela arrive à tout le monde, non ?) ; en voyant le publicain, il n’a pas pu contenir son mépris pour ce collaborateur et il a glissé dans le jugement ! Dommage !
La tentation d’imiter le publicain
Puisque je n’ai pas réussi à être comme le pharisien, il ne me reste qu’à me frapper la poitrine et à répéter la prière du publicain : « Mon Dieu, prends pitié de moi, pécheur. »
Mais je me demande à quel point j’ai vraiment intériorisé l’attitude du pécheur convaincu et repentant. Lui, c’était un pécheur public, sans issue. Moi, je suis prêtre, censé donner l’exemple. Ce n’est pas si simple de prier avec autant de sincérité que ce publicain et de s’en remettre uniquement à la miséricorde de Dieu.
Au moment même où je me déclare pécheur, je remarque ma tendance à me placer un degré au-dessus de mes frères pécheurs. Pécheur, oui, mais… pas trop !
Deux jumeaux dans le sein du cœur
Finalement, je me demande : qui suis-je vraiment ? Le pharisien que je voudrais être ou le publicain que je ne voudrais pas être ? Hélas, je crois que je porte les deux en moi, comme deux jumeaux ! Comment peuvent-ils cohabiter ? Il faudra bien qu’ils apprennent à vivre ensemble.
À mon pharisien, je dis sans cesse de ne pas chercher à se complaire en lui-même, mais à plaire au Père. À mon publicain, je répète inlassablement que Dieu l’aime tel qu’il est. Il n’a pas besoin de mériter l’amour du Père : c’est un don gratuit ! Mieux encore : c’est justement ma pauvreté et ma faiblesse qui attirent les attentions préférentielles de Jésus, venu pour les publicains et les pécheurs.
Parviendrai-je à les éduquer tous deux ? Je ne sais pas, mais j’essaie. Une chose, cependant, je sais : ce n’est que lorsque ces deux-là ne feront plus qu’un que je pourrai entrer dans le Royaume des cieux !
Pour la réflexion personnelle
Méditer sur quelques versets de la première et de la seconde lecture.
Dans la première, Ben Sira (Siracide 35,15-22) nous invite à prier comme le pauvre :
« La prière du pauvre traverse les nuages ; elle ne s’apaise pas avant d’être parvenue à Dieu. Elle ne cesse pas tant que le Très-Haut n’est pas intervenu, rendant justice aux justes et rétablissant l’équité. »
Dans la seconde, Paul — fatigué, vieux et en prison — fait ses adieux à son jeune disciple Timothée avec émotion, en s’en remettant à la justice de Dieu :
« Pour moi, je suis déjà offert en sacrifice, et le moment de mon départ est proche. J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m’est réservée : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. » (2 Tm 4,6-8.16-18).
Puissions-nous, nous aussi, dire ces paroles à la fin de notre vie !
P. Manuel João Pereira Correia, mccj
QUI SUIS-JE POUR JUGER?
Luc 18,9-14
La parabole du pharisien et du publicain éveille souvent chez de nombreux chrétiens un grand rejet envers le pharisien qui se présente devant Dieu arrogant et sûr de soi-même, et une sympathie spontanée envers le publicain qui reconnaît humblement son péché. Paradoxalement, le récit peut éveiller en nous ce sentiment: «Je te remercie, mon Dieu, car je ne suis pas comme ce pharisien».
Pour entendre correctement le message de la parabole, il faut tenir compte du fait que Jésus ne la raconte pas pour critiquer les secteurs pharisiens, mais pour secouer la conscience de «ceux qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres». Nous sommes certainement nombreux, nous catholiques de notre époque, à nous trouver parmi eux.
La prière du pharisien révèle son attitude intérieure: «Oh mon Dieu! Je te remercie car je ne suis pas comme les autres hommes». Quel genre de prière est celle-ci où l’on se croit: meilleur que les autres? Même un pharisien, fidèle observant de la Loi, peut vivre dans une attitude pervertie. Cet homme se sent juste devant Dieu et, précisément à cause de cela, il devient un juge qui méprise et condamne ceux qui ne lui ressemblent pas. Le publicain, par contre, ne réussit qu’à dire: «Oh mon Dieu! Prends pitié du pauvre pécheur que je suis». Cet homme reconnaît humblement son péché. Il ne peut pas se vanter de sa vie. Il se confie à la compassion de Dieu. Il ne se compare à personne. Il ne juge pas les autres. Il vit dans la vérité devant lui-même et devant Dieu.
La parabole est une critique pénétrante qui démasque une attitude religieuse trompeuse, qui nous permet de vivre sûrs de notre innocence, tout en condamnant à partir de notre soit disant supériorité morale, tous ceux qui ne pensent pas ou n’agissent pas comme nous.
Des circonstances historiques et des courants triomphalistes éloignés de l’Évangile nous ont rendus, nous les catholiques, particulièrement enclins à cette tentation. C’est pourquoi, nous devons lire la parabole chacun dans une attitude d’autocritique: pourquoi pensons-nous être meilleurs que les agnostiques? Pourquoi nous sentons-nous plus proches de Dieu que les non-pratiquants? Quel est le fond de certaines prières pour la conversion des pécheurs? Comment réparer les péchés d’autrui en refusant de nous convertir nous-mêmes à Dieu?
À une occasion, face à la question posée par un journaliste, le pape François a fait cette déclaration: «Qui suis-je pour juger une personne gay?». Ses paroles ont surpris presque tout le monde. Apparemment, personne ne s’attendait à une réponse aussi simple et évangélique d’un pape catholique. Cependant, c’est l’attitude de celui qui vit vraiment devant Dieu.
José Antonio Pagola
Traducteur: Carlos Orduna
Juste regard et bonne attitude !
Le Seigneur n’arrête pas de nous surprendre. La semaine dernière, nous avions deux deux figures bien contrastées par lesquelles Jésus nous faisait comprendre qu’il faut toujours prier sans jamais se lasser. Rappelons-nous le juge inique et la veuve; comment tout avait fini par s’arranger tellement la pauvre femme insistait, jusqu’à gagner finalement son point et obtenir justice. De même, et combien plus, nous gagnerons auprès de Dieu, notre Père, si nous persévérons dans la prière.
Aujourd’hui Jésus place encore deux personnages devant nos yeux, qui par leurs démarches contrastantes vont nous instruire sur l’attitude d’un vrai priant. Le meilleur n’est pas celui à qui on aurait pensé d’abord. Regardons nos deux hommes venus au temple pour prier.
Voici d’abord le pharisien : l’homme juste par excellence. Le parfait. Il a le sentiment d’être correct sur toute la ligne. Il a une réputation d’homme vertueux. Il est honoré, respecté par tout le monde dans la société.
Puis arrive ce publicain : celui à qui on reproche bien des choses; il a mauvaise réputation. On le dit voleur, malhonnête, pécheur. On le méprise volontiers. On s’en écarte pour ne pas être contaminé.
Les voilà donc tous les deux venus au temple pour prier Dieu. Regardons-les faire. Chacun y va d’une façon bien différente. Les deux hommes se montrent dans la prière comme ils sont dans le secret et l’intime de leur être, de leur cœur.
La prière du premier – le pharisien – n’est pas vraiment une prière. On peut même se demander s’il croit en ce Dieu qu’il est venu prier. En fait, il ne prie pas vraiment. Il s’étale et se congratule. Il se compare – avantageusement bien sûr – à ceux qu’il côtoie dans la vie. Il n’a besoin de rien ni de personne. Son attente est celle d’un salarier. Sans le dire, il exige. Comme s’il avait droit. Car il n’est pas conscient de sa dépendance et de son immense pauvreté. Le Seigneur ne peut rien faire pour cet homme qui n’arrive qu’à se complaire en lui-même devant Dieu. Sa prétention lui cache sa profonde misère. Il ne se voit pas tel qu’il est.
Mais le publicain, lui, se tient comme un pauvre devant Dieu. Il se sait pécheur. Il n’a pas de quoi se vanter, il le sait bien. Il reste en arrière comme un quêteux, comme un indigne, comme il est. Il ne vient pas faire parade de lui-même, de ses mérites; au contraire il se tient dans la position de celui qui s’offre à Dieu pour qu’il le prenne en pitié. Il ne demande rien de plus parce qu’il sait que Dieu seul peut guérir son cœur et en faire un vase d’élection, faire de lui un être neuf, qui puisse répondre dans la vie à l’amour de son Dieu et Père. Il ne sera plus ce pécheur, mais le gracié de ce Dieu qu’il venait prier dans le temple. Dieu lui-même va le justifier!
Comment prions-nous? Quels sentiments nous habitent devant Dieu? Sachons que notre prière finit par révéler qui nous sommes. Jésus lui-même dans sa prière comme dans sa relation avec nous a voulu se présenter humblement, sans prétention, comme un serviteur, solidaire de nos faiblesses, comme un fils devant son père. Nous donnant l’exemple de l’attitude qu’il faut avoir devant notre Dieu et Père. Nous ne pouvons vraiment prier que si nous sommes des pauvres devant Dieu. Le suffisant, le prétentieux, l’orgueilleux ne peut pas prier vraiment. C’est là un grand malheur! « Qui s’élève sera abaissé; qui s’abaisse sera élevé. »
Deux attitudes possibles
Deux attitudes nous sont possibles en parcourant les textes de ce dimanche.
– Nous préoccuper de nous-mêmes, avec humilité, en observant ce que nous sommes et ce que nous faisons, et en rendant grâce à Dieu non de nos réalisations, mais de son attention à notre égard. En étant attentif au risque de ne plus contempler le Christ en plénitude, mais nous -mêmes.
– Ou bien tourner nos regards vers le Christ, ce qui est plus encourageant que de se contempler avec notre péché d’une manière moralisante.
La réponse se trouve dans les lectures de ce jour :
– Ben Sirac : « Il écoute la prière de l’opprimé. »
– Le psaume 33 : “Le pauvre a crié, Dieu l’écoute et le sauve.”
– Saint Paul qui a une confiance totale en la justice de Celui qu’il a servi et dont il a témoigné devant le tribunal de Rome.
– La parabole du publicain qui, saisi par la sainteté de Dieu, en appelle à sa miséricorde et au salut.
SANS SE DECOURAGER
Ces quatre personnes, en qui nous pouvons nous identifier, sont mis devant nos yeux :
– Avec Ben Sirac, qui ne se sent écouté par personne.
– Le psalmiste qui a le cœur brisé et l’esprit abattu.
– Saint Paul, abandonné même par les siens,
– Le publicain, indigne de regarder vers le ciel.
Mais tous les quatre prient sans se décourager.
– Le pauvre inconsolable persévère dans sa supplication.
– Saint Paul garde une confiance sereine et paisible.
– Le publicain implore pitié.
Et tous quatre sont entendus de Dieu qui trouve chacun disposé “à le servir de tout son coeur” (Ben Sirac), « à le bénir » (psaume) “désirant avec amour la manifestation de sa gloire”. (Saint Paul) Car selon la parole de l’Ecriture que chante l’Alleluia :”L’homme regarde à l’apparence, mais Dieu regarde au coeur.” (1 Samuel 16. 7)
Nous sommes souvent déconcertés par le temps qui reste sans réponse en apparence. Nos frères aussi s’impatientent qui s’attendent à une prière exaucée sans délai. Il est alors difficile de leur en parler avec des mots humains comme il est tout autant difficile, pour nous, de nous laisser conduire par le Christ jusqu’à ce détachement que représente l’abandon total à la bonté de Dieu.
Non pas seulement l’abandon à sa volonté, mais l’abandon à sa bonté.
L’ESSENTIEL ET LA JUSTICE
Maintenant, si nous relisons et méditons la parabole du pharisien et du publicain à la lumière de Ben Sirac, nous percevrons quelle doit être la réalité de notre conversion. Ses exigences ne peuvent s’estimer quantitativement au terme d’une addition.
La justice, au sens biblique du terme, signifie en effet l’ajustement de nous-mêmes, de notre volonté et de notre comportement, à Dieu lui-même. Et cela ne peut se réaliser que dans le Christ-Jésus, qui unit notre humanité à sa divinité. C’est en cela qu’il pleinement le Juste.
Etre juste ne provient pas seulement du fait que soyons attentifs et « intègres » sur tous les commandements de Dieu, ni même du fait d’accumuler des pratiques morales et charitables.
Le pharisien s’en prévalait. Il croyait prier. En fait il ne célébrait que lui-même. Il ne célébrait pas les dons de Dieu. Trop satisfait de ses propres réussites. Ce subtil orgueil détruisait en lui toute justice alors qu’il s’estimait en relation avec la volonté de Dieu. Mais était-il en relation avec la bonté, avec l’amour de Dieu à son égard et à l’égard de ses frères ?
Le publicain, saisi par la sainteté de Dieu, aurait voulu disparaître comme saint Pierre après la pêche miraculeuse : « Eloigne-toi de moi, Seigneur, je ne suis qu’un pécheur. » (Luc. 5. 8) Il mesurait la distance entre lui et le Seigneur Trois-Fois-Saint. Il se croyait très éloigné de la justice de Dieu, et en restait à distance. En fait, c’est lui qui était le plus proche, car il implorait l’essentiel de Dieu, c’est-à-dire sa miséricorde et son amour infini.
”Le Seigneur me remettra sa récompense, disait saint Paul, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire.” Le pharisien ne manifestait que sa gloriole personnelle, bien fragile et bien minime en regard de l’immensité de l’amour de Dieu…
Le pharisien ne pouvait entrer en possession du mystère puisqu’il se mettait au centre de sa prière. Le publicain s’est élevé jusqu’au mystère du salut parce qu’il ne pensait d’abord qu’à la gloire de Dieu.