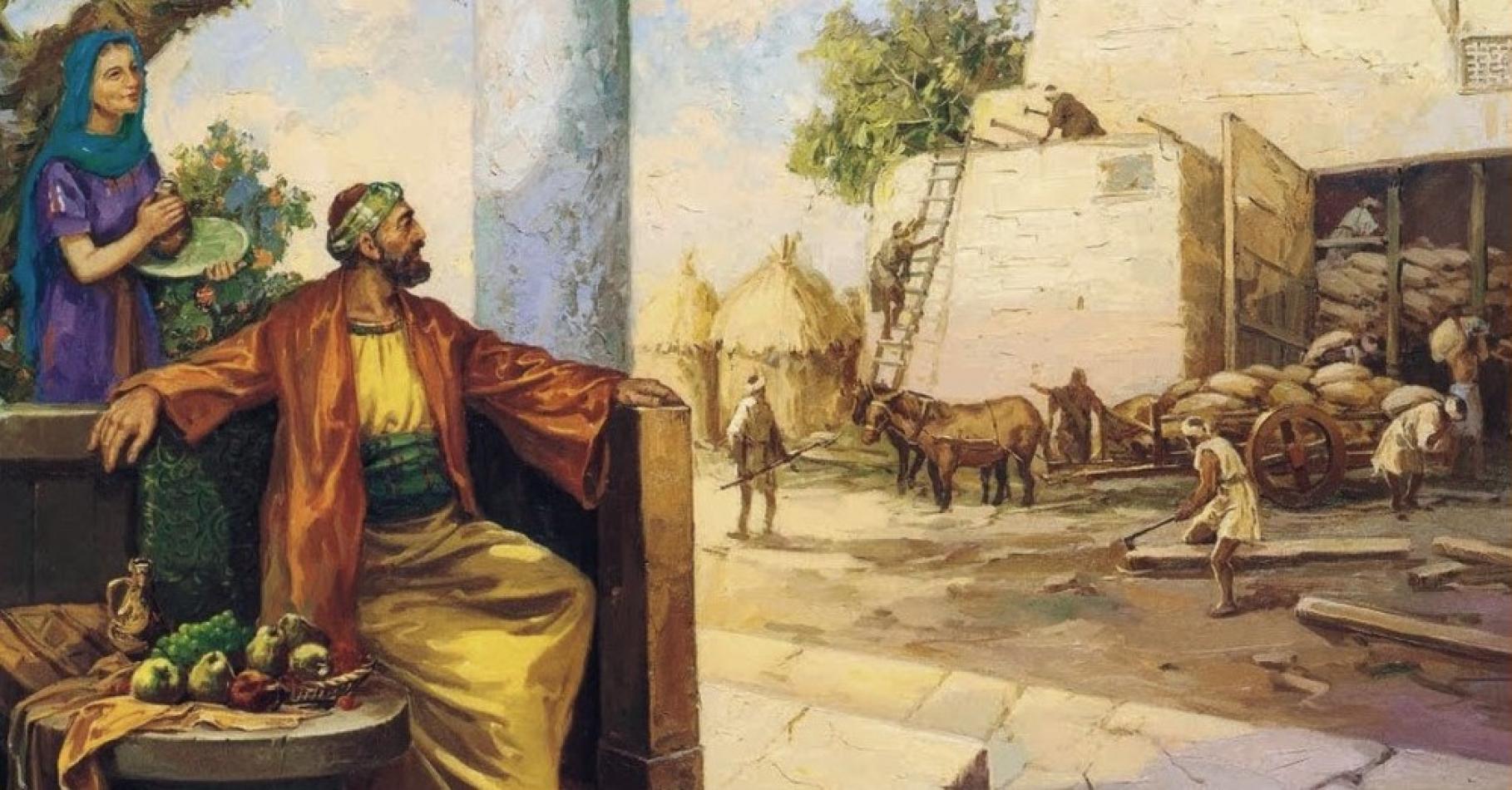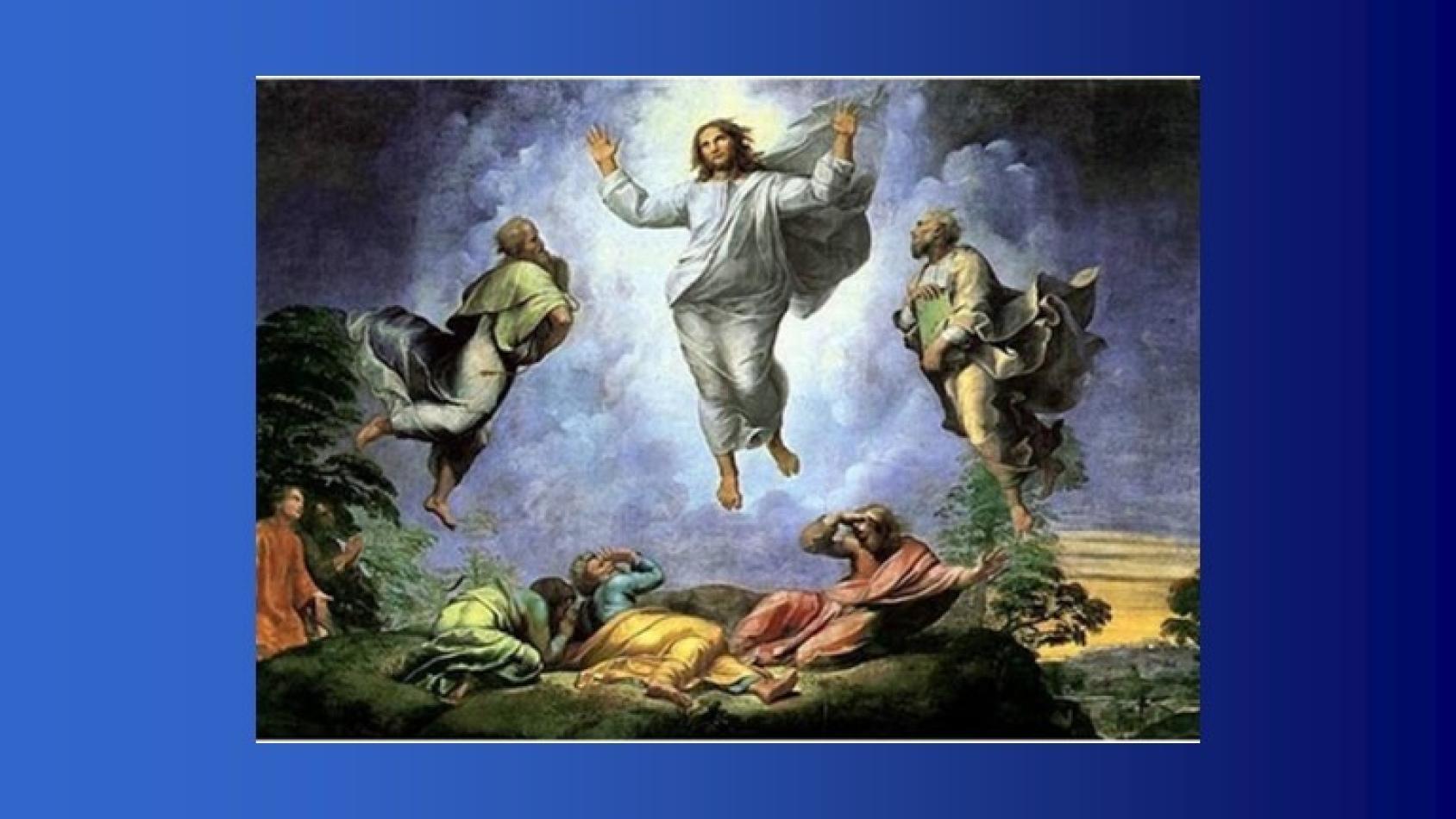Daniel Comboni
Missionnaires Comboniens
Zone institutionnelle
D’autres liens
Newsletter
L’être humain aura toujours besoin d’être sauvé de lui-même, et aucune société ne parviendra à l’arracher à sa fascination pour le mal. Le monde sera toujours menacé par le péché, par les égoïsmes individuels et collectifs. Qu’il s’agisse d’idéologies totalitaires, de guerres de religion ou de notre échec écologique lamentable. Nous avons besoin d’être sauvés de nous-mêmes et nous n’y parviendrons jamais sans Dieu, sans cette action rédemptrice du Christ ressuscité au cœur de nos vies et de nos sociétés.
« Gardez-vous de toute avidité. »
Luc 12,13-21
Nous marchons avec Jésus, guidés par l’Évangile de Luc. Nous avançons vers Jérusalem. Il y a quelque temps, Jésus, « lorsque approchait le temps où il allait être enlevé au ciel, prit résolument la route de Jérusalem » (Lc 9,51). En chemin, le Seigneur rencontre des personnes et enseigne. Dimanche dernier, Jésus nous parlait de la prière. Aujourd’hui, il va nous parler de l’usage des biens, un thème particulièrement cher à saint Luc.
1. « Quelqu’un dans la foule dit à Jésus »
Tout part de l’intervention d’un homme dans la foule qui demande à Jésus d’ordonner à son frère aîné de partager l’héritage avec lui. Jésus lui répond, quelque peu agacé : « Homme, qui m’a établi pour être votre juge ou votre arbitre ? ».
Voici un homme quelconque ! Lorsqu’un personnage apparaît sans nom dans l’Évangile, soyons attentifs : il se réfère probablement à nous. En effet, cet homme représente beaucoup d’entre nous (et en disant « nous », je pense à moi aussi !). Jésus venait juste de dire : « Cinq moineaux ne sont-ils pas vendus pour deux sous ? Et pas un seul d’entre eux n’est oublié devant Dieu. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N’ayez pas peur : vous valez plus que beaucoup de moineaux ! » (Lc 12,6-7). Mais cet homme pensait à autre chose. Il était préoccupé parce que son frère avait pris l’héritage et refusait de lui en donner la part qui lui revenait.
Il en va souvent de même pour nous. Jésus, la Parole, parle, mais notre esprit est ailleurs. Nous sommes absorbés par nos préoccupations et nous préférerions que le Seigneur, au lieu de nous parler d’autre chose, vienne résoudre nos problèmes !
Seigneur, quand je me dispose à t’écouter, que je vide mon cœur de tout problème et souci, de tout sentiment et émotion, de toute pensée et désir, pour faire place à ta Parole !
Quelqu’un dans la foule ! Jésus était entouré de ses disciples et de milliers de personnes (cf. Lc 12,1). Cet homme était au milieu de la foule. La position de cet homme est significative. Il fait partie de la foule. Cela me fait penser que la foule est le « lieu » de beaucoup de chrétiens aujourd’hui. Oui, ils sympathisent avec Jésus, mais gardent une certaine distance par rapport à lui et à ses enseignements. Se rapprocher de lui est trop engageant dans une société de plus en plus indifférente, voire hostile, à la foi chrétienne. Être proche du Christ, ne serait-ce que par notre façon de parler, peut nous mettre dans la gêne, comme Pierre lorsqu’il fut reconnu au moment du procès de Jésus : « Celui-ci aussi était avec lui ; d’ailleurs, il est Galiléen » (Lc 22,59).
Seigneur, tu m’as appelé hors de la foule en m’appelant par mon nom (Lc 6,13-16). Donne-moi, Seigneur, l’Esprit de force, afin que je surmonte la peur et la lâcheté chaque fois que je suis appelé à témoigner de ton nom !
2. « Un homme riche »
En tant que prophète, Jésus se place immédiatement sur un autre plan et avertit ses auditeurs du danger des richesses : « Faites bien attention, et gardez-vous de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède ».
La richesse, l’argent, les biens sont peut-être les plus grands idoles de ce monde, car ils nous donnent une impression de sécurité et la sensation que tout est possible, même le bonheur. Ce n’est pas un hasard si saint Paul, dans la deuxième lecture (Colossiens 3,1-11), met les chrétiens en garde contre « cette avidité qui est une idolâtrie ». À cet idole, des milliers de vies sont sacrifiées chaque jour sur l’autel du profit.
Un homme riche, chanceux ! Pour approfondir son enseignement, Jésus raconte la parabole d’un homme riche qui a la chance d’avoir une récolte exceptionnelle. Qui est-il ? À première vue, ce n’est pas nous. Mais si nous regardons bien, nous pourrions le retrouver tapi dans la pièce des désirs de notre cœur. Il est difficile de trouver quelqu’un qui ne rêve pas d’être riche.
Que vais-je faire ? Je vais faire ceci ! Mais cet homme a un problème : ses greniers sont trop petits pour stocker tous ses biens, et il se demande : « Que vais-je faire, car je n’ai pas de place pour engranger ma récolte ? ». Il trouve vite une solution : « Voici ce que je vais faire – dit-il – : j’abattrai mes greniers, j’en construirai de plus grands… ». C’est un homme pratique et déterminé, comme l’intendant malhonnête dans une autre parabole de Jésus (cf. Lc 16,1-8).
Cette question « Que vais-je faire ? » revient souvent dans les écrits de saint Luc (cf. aussi 3,10.12.14 ; 16,3.4 ; Ac 2,37 ; 16,30). C’est une question que nous devrions nous poser plus souvent : elle aide à discerner ce qu’il faut faire, au lieu de laisser les choses empirer ou laisser les autres décider à notre place.
Ce qui frappe chez cet homme, c’est son égocentrisme. Il ne pense qu’à lui : « je démolirai… je construirai… je rassemblerai… ». Lui et ses biens : « mes récoltes… mes greniers… mes biens… ». Aucun de nous ne penserait ainsi, n’est-ce pas ? Peut-être dirions-nous :
– « Si j’étais riche, je saurais quoi faire : j’aiderais mes proches, bien sûr, et les pauvres ! ».
– Mais tu es riche ! Pense à tous les talents que le Seigneur t’a confiés : quel usage en fais-tu ?
3. « Insensé ! »
L’homme riche de la parabole n’a pas d’interlocuteur. Il « réfléchissait en lui-même » et ne parlait qu’à lui-même : « Mon âme, tu as de nombreux biens en réserve pour de nombreuses années ; repose-toi, mange, bois, fais la fête ! ». À ce moment, un interlocuteur inattendu intervient : « Mais Dieu lui dit : ‘Insensé, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ?’ ».
Est-ce un Dieu rabat-joie qui parle ? Non, c’est simplement la voix de la conscience qui nous ramène à la réalité de la vie, comme nous l’entendions dans la première lecture de Qohélet : « Vanité des vanités, tout est vanité ! ».
Gardons notre conscience éveillée, laissons-la crier : « Insensé ! », pour qu’elle n’ait pas à le faire, à la fin, au moment du bilan de notre vie : « Insensé, qu’as-tu fait de ta vie ?! »
Proposition de vie
Jésus termine la parabole en disant : « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu ». Ailleurs, à la fin de la parabole de l’intendant malhonnête, il conclut : « Eh bien ! moi, je vous le dis : faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles » (Lc 16,9). Et saint Basile dit à l’homme riche – et à nous : « Si tu veux, tu as des greniers : ce sont les maisons des pauvres ».
Seigneur, conscients de notre fréquente folie dans la vie, nous te demandons humblement avec le Psalmiste : « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse » (Psaume 89).
P. Manuel João Pereira Correia, mccj
À l’écoute de la parole de Dieu
Luc 12,13-21
« Gnothi seauton », connais-toi toi-même, précepte gravé à l’entrée du temple de Delphes et commenté longuement par Platon. C’est-à-dire : sache quelle est ta place, ton rôle, pour t’y tenir et ne pas entrer dans l’hubris. Les textes de ce jour reprennent cette sentence si importante, mais avec quelques nuances !
Le sage Qohéleth est un homme désabusé et pessimiste. Il constate l’inanité de nos efforts, « vanité des vanités », l’homme ne sait pas suivre le conseil de Delphes et en paye le prix. Le psaume est une prière de supplication, pour que Dieu vienne répondre à ce pessimisme : « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse » ; avec Jésus on dira « donne-nous ton Esprit ».
La clé, une fois encore, est fournie par Paul, dans l’épître aux Colossiens : « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut », et comme à l’accoutumée il ne fait pas dans la dentelle : « Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre ». Mais il faut poursuivre la lecture, ce qu’il appelle « la terre », qu’il appelle ailleurs « les œuvres de la chair », ce sont le mensonge, la débauche, etc. Car sinon c’est bien en nous préoccupant de la terre que nous préparons le Royaume, seulement nous devons savoir que cet engagement sur la terre est tiré en avant par l’espérance qui nous fait vivre, un monde dans lequel « il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme libre », espérance qu’alors le Christ soit « tout en tous ».
Pour conclure, la petite parabole de Jésus nous rappelle que si nous oublions cette espérance qui nous fait vivre, il n’y aura plus qu’à en revenir au pessimisme de Qohéleth : sérieusement, que croyons-nous vraiment ? Où est notre confiance ? En qui ? À quelle aune mesurons-nous notre vécu ? Qu’est-ce qu’une vie réussie ?
[Marc Durand - http://www.garriguesetsentiers.org]
Commentaire
L’homme, j’en suis convaincu, ne naît ni meilleur ni pire qu’à l’aube de l’humanité. Il est toujours cet être fragile et mortel, en manque de salut. Bien sûr, s’il naît dans un milieu porteur, dans une société « éclairée », ce cadre pourra lui être utile afin de grandir en humanité. Mais le mal étant toujours présent dans notre monde, ces structures sociales, aussi avancées soient-elles, pourront toujours se retourner contre ses citoyens et les entraîner dans les horreurs les plus abjectes au nom de cette même humanité que ces sociétés sont censées protéger. L’Allemagne nazie en est un parfait exemple.
L’être humain aura toujours besoin d’être sauvé de lui-même, et aucune société ne parviendra à l’arracher à sa fascination pour le mal. Le monde sera toujours menacé par le péché, par les égoïsmes individuels et collectifs. Qu’il s’agisse d’idéologies totalitaires, de guerres de religion ou de notre échec écologique lamentable. Nous avons besoin d’être sauvés de nous-mêmes et nous n’y parviendrons jamais sans Dieu, sans cette action rédemptrice du Christ ressuscité au cœur de nos vies et de nos sociétés. C’est l’écrivain Umberto Ecco qui écrivait : « Lorsque l’homme cesse de croire en Dieu, ce n’est pas qu’il ne croit plus en rien, il croit alors en n’importe quoi ».
« Vanité des vanités », nous dit le sage au livre de l’Ecclésiaste, si nous mettons notre salut en ce monde qui passe, alors que le psalmiste fait entendre sa supplication qui garde toute sa valeur au fil des âges : « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse. »
Cette sagesse, c’est le Christ, lui qui nous invite à devenir riche en vue de Dieu, au lieu de marcher tête baissée, les yeux rivés sur les biens passagers de cette terre, possessions que nous ne pourrons jamais emporter avec nous au paradis : terres et maisons, gloire et talents, richesses et réputation. Tous ces biens ne peuvent constituer le dernier mot d’une vie humaine, même s’il est vrai que nous ne pouvons vivre en ce monde de manière désincarnée.
Pour nous chrétiens et chrétiennes, nos vies d’hommes et de femmes prennent leur enracinement dans notre foi en Dieu, et dans l’évangile qui nous conduit au Christ. À son école nous apprenons à nous tenir debout dans le monde, tout en n’étant pas du monde, refusant de nous soumettre aux valeurs qui sont en contradiction avec l’évangile.
Bien des témoins se tiennent ainsi parmi nous dans des vies humbles et cachées. Ce matin, j’aimerais vous parler d’un tel homme. Il se nomme Clovis, et il a été pour moi un père spirituel, alors que jeune adulte, je découvrais le Christ. Je me souviens de ces longues heures passées en sa compagnie, soit dans la cuisine familiale, ou dans son beau jardin qu’il entretenait avec tant de soin et où, tous les étés, une place d’honneur était réservée à une statue de la Vierge Marie. Nous discutions de théologie ensemble, de l’histoire de l’Église, de la vie des saints et des saintes, sans jamais me lasser de ces heures bénies.
Clovis était un homme de foi, et lorsque je suis allé lui rendre visite à l’hôpital, alors qu’il ne lui restait que quelques jours à vivre, il est vite allé à l’essentiel. Il m’a parlé de Dieu, de sa foi en ce moment d’épreuve, il m’a parlé de la mort, de sa mort prochaine, me disant que sans vouloir être prétentieux, cette mort ne lui faisait pas vraiment peur, que l’idée de rencontrer Dieu n’éveillait pas vraiment de crainte en lui. « Je n’ai pas peur de Dieu », me disait-il. « Peut-être devrai-je avoir une certaine crainte », avait-t-il poursuivi, « mais Dieu est avant tout un ami pour moi, je me sens en confiance, il va m’accueillir tel que je suis ».
Toute sa vie mon ami Clovis a été conscient de sa fragilité, de sa condition de pécheur, et c’est pourquoi il s’en est toujours remis à la miséricorde de Dieu, et ce, jusque sur son lit de mort, dans une joyeuse espérance, dans une vie de foi épanouie et généreuse, dans une fidélité patiente qui attend tout de Dieu. Clovis n’était pas surhumain. Il était tout simplement un chrétien qui prenait au sérieux sa vie de foi et qui chaque jour la remettait sur le métier à travers l’eucharistie quotidienne, la prière, la lecture, le bénévolat, l’accueil du prochain.
Pour comprendre l’action de Dieu en nous, j’aime bien la comparer à ces merveilles de la technologie biomédicale où des personnes, afin de sauver un membre de leur famille ou un ami, vont donner de leur sang ou de la moelle osseuse ou un rein à la personne aimée. Ces personnes aiment tellement l’autre qu’elles sont prêtes à donner une partie d’elle-même afin de sauver l’autre.
Dieu lui, il a tellement aimé le monde qu’il nous a donné son Fils, son Unique. Il a voulu transplanter sa vie en nous. C’est cela le don de la grâce. Dieu nous aime tellement qu’il veut mettre en nous un cœur neuf pour aimer comme lui, pour voir l’autre dans toute sa réalité d’enfant de Dieu.
Le croyant qui se reçoit ainsi de Dieu est appelé à être un témoin de l’amour de Dieu et de sa miséricorde. Il sait qu’en dépit de ses faiblesses, Dieu est avec lui et l’accompagnera tous les jours de sa vie. C’est pourquoi, tout en reconnaissant ses fragilités et ses limites, il n’a pas peur de se tenir en présence de Dieu. Et c’est ainsi que l’on fait de Dieu son TOUT, son bien le plus précieux, alors que tout le reste pâlit en comparaison et trouve en même temps sa juste place dans nos vies.
C’est cela revêtir l’homme nouveau dont parle saint Paul : c’est se revêtir de la charité même de Dieu qui s’est révélée en Jésus Christ, lui qui de riche qu’il était s’est fait pauvre pour nous, afin que nous devenions riches en vue de Dieu. Car Jésus nous enseigne que nous avons une destinée ouverte sur l’infini, et que nous enfermer dans un égoïsme défensif, qui nous rendrait sourds aux besoins du monde, ce serait refuser d’assumer le sérieux de l’évangile.
Christian de Chergé disait à ses frères moines de Tibhirine : « Je sais n’avoir que ce petit jour d’aujourd’hui à donner à Celui qui m’appelle pour TOUT JOUR, mais comment lui dire oui pour toujours si je ne lui donne pas ce petit jour-ci… Dieu a mille ans pour faire un jour ; je n’ai qu’un seul jour pour faire de l’éternel, c’est aujourd’hui ! » (Christian de Chergé. Chapitre du 30 janvier 1990)
Yves Bériault, o.p.
Dominicain. Ordre des prêcheurs
https://moineruminant.com